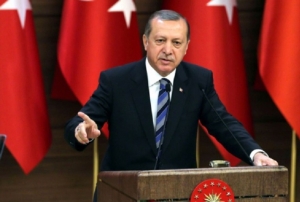De passage à Abidjan, KEE CHONG LI, PCA Afreximbank s’est entretenu avec La Diplomatique d’Abidjan (LDA) sur divers sujets en rapport avec le développement du continent africain.
LDA : Vous êtes de passage à Abidjan. Pouvez-vous vous présenter et nous donner les raisons de votre présence ici ?
KC Li : Merci à vous pour cet entretien. J’ai été le Président du Conseil d’Administration de la Banque d’Etat de Maurice. J’ai été aussi pendant longtemps au service financier banque, assurance, courtage et échange de fortune. Je suis en ce moment membre du conseil d’administration d’Afreximbank. C’est une Banque Commerciale d’Afrique. Elle finance les échanges commerciaux qui se font au niveau intra africain. Dans ce contexte, Afreximbank voudrait aider à promouvoir les produits africains parce qu’on parle des zones de libre d’échange d’Afrique. Mais il faut avoir les produits africains pour pouvoir faire les échanges et pour pouvoir faire les échanges de produits africains. Il faut la finance, il faut le crédit commercial. Dans ce contexte, elle veut promouvoir les articles, les produits et les services africains dans un évènement panafricain à travers une exposition et une conférence africaine. Justement parce qu’il parait que Abidjan est doté d’une grande salle de conférence, d’exposition de convention center. On aurait donc souhaité de tenir ce grand évènement à l’occasion de l’ouverture de ce grand centre des affaires. C’est pourquoi nous sommes venus à Abidjan pour signer un accord avec le gouvernement de Côte d’ivoire pour que les deux organisations que sont, le Ministère de l’Industries du Commerce de Côte d’ivoire et la Banque Afreximbank qui travaillent de concert avec la zone de libre-échange Africaine pour promouvoir et organiser cette foire panafricaine.
LDA : Sur la question de zlecaf, personnellement quelle est votre vision sur cet instrument de commerce en Afrique ?
KC Li : La zlecaf est une instance primordiale pour favoriser le commerce intra africain. L’Afrique a ses mauvaises habitudes depuis la colonisation d’importer tous les produits de l’Europe ou ailleurs et d’exporter tous ses matières premières ou ses produits primaires directement à l’étranger. Rien ne se fait pour transformer ses matières premières en Afrique. Les produits sont importés c’est donc une situation qui n’est pas soutenable car elle fragilise son économie. Deuxièmement, il n’y a aucun échange entre les pays africains parce que pour qu’on puisse vendre du pétrole par exemple de l’Angola pour le fournir au bénin, le pétrole doit être traité en hollande pour l’exporter au bénin. Ce qui n’est pas normal. Il faut que la transformation se fasse au niveau de l’Afrique. On peut traiter nos matières premières en Afrique et les revendre en Afrique.
LDA : Il faut donc la soutenir…
KC Li : La Zlecaf est une instance primordiale pour favoriser ce libre échange parce ce, ce qui bloque cet échange, c’est d’abord les tarifs, ensuite la logistique et enfin la monnaie. Parce que chaque État a sa propre monnaie. La Zlecaf ne peut pas opérer le changement toute seule. Elle doit s’associer avec Afreximbank pour avoir le financement avec les banques centrales pour qu’il y ait une monnaie qui est échangeable au niveau de l’Afrique. Elle doit aussi s’associer avec l’Union Africaine pour avoir une vision stratégique de ce que veut faire l’Afrique comme zone frange libre. Les Etats doivent travailler dans l’écosystème pour que l’Afrique puisse devenir un continent unique et uni.
LDA : Pensez-vous que l’Afrique peut y arrivée étant donné qu’il y’ a des États qui trainent encore les pas ?
KC Li : l’Afrique prend son temps, l’Afrique a déjà pris beaucoup de temps. donc on devra prendre encore un peu de temps mais, il faut avoir la vision et les visions sont bonnes. Il faut également la volonté pour les réaliser. Donc, pour pouvoir avoir la volonté il faut avoir les moyens et les moyens nous les avons. Nous allons faciliter des crédits pour permettre les échanges commerciaux et un système de payement sera mise en place. De ce fait, nous n’aurons plus besoin de faire des échanges en dollars pour le reconvertir en monnaie africaine.
LDA : Aujourd’hui, nous constatons que l’Afrique a grandi, il y a beaucoup d’attraction. Selon vous, qu’est-ce qui peut expliquer cet engouement vers ce continent ?
KC Li : l’Afrique est riche en ressources minérales, matières premières, matériels et même en capitale humain. Tous les grands footballeurs sortent de l’Afrique pour aller jouer en Europe, tous les grands artistes sont en Europe. L’Afrique exporte son capital humain, elle exporte tout ce qu’elle produit sur sa terre. Ce n’est pas normal, l’Afrique doit pouvoir se développer. Elle doit pouvoir transformer ses matières premières, doit pouvoir utiliser sa matière grise pour développer le continent. C’est ce que nous essayons de faire chacun à son niveau, que ça soit de grandes instances multilatérales et panafricaines comme les institutions individuelles. Alors qu’est-ce qui explique cet engouement vers ce continent ? Je pense que l’Afrique a beaucoup de potentielles, une population jeune et bientôt elle aura la plus grosse population du monde parmi tous les continents. C’est donc un vaste marché et il suffit juste d’avoir une bonne croissance soutenue années après années. Ce continent pourra arriver au même niveau des pays émergeants et dépassé même les grands pays comme le japon, la Corée. L’Afrique devient aussi puissante que la chine et pourquoi ne pas la dépasser comme la chine a fait avec les Etats-Unis.

LDA : Par ailleurs, vous êtes le président du Club des Amis de la Chine a l’île Maurice et l’océan indien. Qu’est-ce qui a motivé la création de ce club à Maurice ?
KC Li : Nous avons les générations de longues date, parce qu’il y’a beaucoup de chinois qui sont venu s’établir à Maurice. Il y’ a une petite population mauricienne d’origine chinoise. Ils ont tous des relations avec la chine et de là, s’est bâtie des relations amicales entre, pas seulement la communauté mauricienne d’origine chinoise mais aussi toute la population diverse de Maurice se sont liés d’amitié avec la chine et s’est tenue debout pour Maurice dans les moments difficiles. L’Afrique a beaucoup bénéficié de l’aide de la Chine. La chine a aidé les mouvements de libération de l’Afrique dans le même contexte. La chine a beaucoup aidé Maurice pour devenir libre, fort et se développer économiquement. La Chine a doté Maurice de nouveaux aéroports dont personnes ne voulait financer. Les stades de football et des stades olympique, des hôpitaux, développer des ports. Ces actions ont beaucoup aidé Maurice. Les populations sont très heureuses. Ils sont également très amis avec l’Afrique. Parce que, c’est un ami de toutes les saisons, ce n’est pas un ami qui est présent aujourd’hui et demain il part comme il l’on fait en Afghanistan.
LDA : Pouvez-vous faire part de quelques actions que vous avez menées à Maurice depuis la création de votre structure ?
KC Li : Nous avons organisé des spectacles les plus oasis. Nous avons aidé à faire venir des coachs chinois dans le domaine sportif. Nous avons aidé à la promotion de la cuisine chinoise, nous avons aidé à développer la calligraphie paper-cating (découpage de papier). Nous avons également fait des gestions des étudiants mauriciens vers la chine. Nous avons fait plusieurs activités de vacances. Des échanges entre peuples, ce n’est pas une action d’ordre c’était entre peuple. Les jeunes et les femmes, les arts, la cuisines, la santé la médecine traditionnelle beaucoup d’activités.
LDA : Aujourd’hui, comment appréciez-vous les rapports sino-Afrique et le reste du monde ?
KC Li : il faut que les africains comprennent que les chinois ont toujours été présent pendant la période dure de colonisation, de l’impérialisme oû les africains ont été exploité. Ils étaient devenus esclaves et ils ont volé leurs matières premières. Ils ont aussi volé leur mine et rien n’a été fait. Les personnes sont illettrées mais la chine a été le seul pays qui a aidé à faire des routes, des trains, des aéroports, avec des Bolloré, des générales électriques. Vous comprenez que la chine a toujours été sincère avec l’Afrique.
LDA : Selon vous, comment l’Afrique doit-elle bénéficier de tous ces expertises chinoises ?
KC Li : Rester ami et bénéficier de l’amitié. C’est la base de leur relation. Je te respecte tu me respectes. Je m’ingère pas dans tes affaires, tu t’ingères pas dans les miennes et allons trouver une coopération gagnant-gagnant. Voici comment les Etats africains doivent profiter.
LDA : Nous sommes au terme de cet entretien, quelque chose de particulier que vous voulez ajouter ?
KC Li : je suis de passage ici. Tout simplement merci.
Entretien réalisé par Mohamed Compaoré