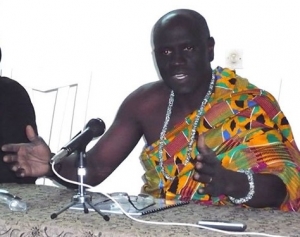Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been....
Armand Tanoh
Côte d’Ivoire-Déclaration de patrimoine : des ministres pourraient être poursuivis
La haute autorité pour la bonne gouvernance (HABG) va engager des poursuites contre toutes les personnalités qui refusent de faire leur déclaration de patrimoine dans le délai imparti, a averti le secrétaire général de la HABG, Yves Yao Kouamé dans une interview accordée à un quotidien de la place.
« Les ministres qui n’ont pas effectué leur déclaration dans le délai imparti seront poursuivis conformément aux textes en vigueur », a déclaré le secrétaire général de la HABG dans le quotidien Fraternité Matin dans sa parution du lundi.
« Les ministres qui ont été reconduits et n’ont toujours pas effectué leur déclaration seront non seulement poursuivis conformément à la loi mais ils vont aussi devoir justifier l’origine de l’ensemble de leur patrimoine », a insisté M. Yao assurant que « la procédure prévue par les textes sera appliquée dans toute sa rigueur ».
Le secrétaire général de la HABG a par ailleurs révélé dans cette interview que la HAGB envisage d’autres dispositions notamment la modification de l’article 5 de l’ordonnance 2013-660 du 20 septembre 2013 en vue d’intégrer les magistrats aux personnes assujetties à l’obligation de déclaration de patrimoine ainsi que les candidats aux mandats électifs qui devront effectuer leurs déclarations de patrimoine avant les élections. Le récépissé de déclaration fera partie des pièces constitutives du dossier de candidature.
Créée par l’ordonnance n°2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance (HABG) est un organe de la prévention et de la répression des actes de corruption et des infractions assimilées. Démarrée le 11 juin 2015, l’opération de déclaration a enregistré au 31 mars 2016, 2685 déclarations sur une population cible de 4459 personnes, d’après le rapport d’exercice 2015.
AIP
Côte d’Ivoire : Des opposants pas d’accord avec le projet de loi sur le statut de l’opposition
Une coalition de quatre formations politiques de l’opposition ivoirienne regroupée au sein du Cadre pour la restauration nationale et la démocratie (CRED) s’insurge contre l’adoption, par le gouvernement ivoirien, d’un projet de loi portant statut de l’opposition, notamment en son point relatif aux procédures de désignation d’un leader de l’opposition à la fonction de chef de l’opposition, qui selon ce groupement politique sont « loin d’être porteuses de solutions et de progrès et constituent un frein à la démocratie ».
Selon un communiqué du CRED dont l’AIP a eu copie lundi, les articles de ce projet de loi, qui désignent le candidat arrivé en deuxième position, lors de la dernière élection présidentielle comme chef de l’opposition sont « inappropriées et peu judicieuses ».
Selon cette coalition, cette démarche gouvernementale « semble peu pertinente en ce qu’elle n’a pas envisagée qu’un candidat indépendant, sans appareil politique pourrait se trouver en 2ème position et devenir ainsi le chef de file de l’opposition».
Le CRED qui comprent quatre partis, à savoir le Parti ivoirien des travailleurs (PIT), le Rassemblement pour la paix (RPP), l’Union républicaine pour la démocratie (URD) et le l’Union des sociaux démocrates (USD), invite le gouvernement « à sursoir à l’exécution de cette mesure et d’ouvrir de franches discussions au sein du Cadre permanent de dialogue (CPD) pour étudier ce projet de loi selon des critères objectifs », conclut le communiqué.
Le gouvernement ivoirien a adopté en Conseil de ministre, la semaine écoulée, un projet de loi portant statut de l’opposition, dont une disposition stipule que le candidat arrivé en seconde position lors de la dernière élection présidentielle sera désigné comme chef de l’opposition. Le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné Koné avait expliqué au terme de ce Conseil que cette loi est destinée à consolider la démocratie en Côte d’Ivoire.
AIP
Côte d’Ivoire/Conflit de Bouna : Il faut instituer une « charte de cohabitation fraternelle », propose le Pr Amoa Urbain
Le recteur de l’université Charles-Louis de Montesquieu d’Abidjan-Cocody, Pr Urbain Amoa, propose « une charte de cohabitation fraternelle » et un projet d’organigramme structurant les sociétés centralisées (Koulango) et libres (Lobi et Peuhl).
Amoa Urbain a fait ces propositions, lundi, lors d’une conférence de presse à l’issue d’une mission de médiation qu’il a entreprise du 02 au 09 avril pour le dialogue intercommunautaire entre Lobi, Kolango et Peuhl après les affrontements sanglants et meurtriers qui ont embrasé le département de Bouna pour des questions de cohabitation entre éleveurs et agriculteurs et entre agriculteurs et orpailleurs.
Le promoteur du festival des rois et chefs traditionnels dénonce le défaut d’anticipation de gestion du conflit de Bouna, pourtant latent depuis lurette, et propose l’ouverture des quatre sous-préfectures créées mais non-fonctionnelles pour une gouvernance de proximité et des centres d’incubation pour l’élevage et l’agriculture dont le projet pilote a été inauguré à Assoum 1 par le préfet Tuo Fozié.
Soutenu par l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et l’UNESCO, l’initiative de M. Amoa a consisté en ce qu’il a qualifié « d’immersionnisme » pour comprendre « les nœuds cachés » de la crise, et proposer des pistes de solution consensuelles favorisant la cohabitation pacifique entre ces communautés.
Fondées sur la diplomatie coutumière et l’élégance langagière, la démarche et l’approche scientifiques d’Amoa Urbain lui ont permis de relever les croyances aux complexes de supériorité ou d’infériorité, les difficultés de la diversité culturelle qui devraient conduire à la convergence et non à la divergence, les questions de gestion des flux migratoires, d’injustice de traitement des conflits par les tribunaux ou encore la méconnaissance de l’histoire et de la culture et l’impunité.
Avant le lancement des activités du second centre d’incubation à Bromakoté, une deuxième phase du dialogue intracommunautaire incluant l’ensemble des cadres est prévue les 20 et 21 avril, a annoncé le médiateur en Centre Afrique de l’UNESCO lors de la conférence qu’il tenait à l’université Charles-Louis de Montesquieu à Abidjan-Cocody.
AIP
Côte d’Ivoire : Ben Soumahoro décédé à Accra
Mamadou Ben Soumahoro, homme politique ivoirien proche de l'ancien président Laurent Gbagbo, mais aussi ancien directeur général de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI, années 1980), est décédé lundi à Accra, au Ghana, où il vit en exil depuis la fin de la crise postélectorale qui avait secoué la Côte d’Ivoire en 2010-2011.
Journaliste, Ben Soumahoro a marqué son passage à la télévision ivoirienne avec l’émission « Le Fauteuil blanc » qu’il présentait dans les années 80.
Proche de l’ancien président, Laurent Gbagbo, Ben Soumahoro a été également militant du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) et du Rassemblement des républicains (RDR).
Côte d’Ivoire: Policiers et gendarmes ivoiriens se forment aux droits et à la protection de l’enfant
Quarante six policiers et gendarmes ivoiriens, dont deux issus du commissariat et deux brigade de gendarmerie d’Agboville, ainsi que 42 des unités d’interventions d’Abidjan, participent depuis lundi à Agboville, à un atelier de renforcement des compétences en droits et protection de l’enfant, sous le couvert de l’Organisation des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).
Ces formations continues en droits et protection des enfants permettront, à court terme, la mise en place de points focaux en protection de l’enfant, au sein des unités, avant plus tard, la création à long terme, de sections spécialisées en la matière, a expliqué colonel Bakayoko Lassana, chef du Bureau Organisation Emploi (BOE) de la gendarmerie, intervenant au des deux corps.
Au total, 392 policiers et gendarmes ont été formés à ce jour, depuis le premier atelier du genre tenu en novembre 2012, à Man (ouest de la Côte d’Ivoire), a ajouté le Capitaine Oua Detoh Fulgence, Officier adjoint à l’école de formation des gendarmes de Toroguhé, et co-président de la cellule technique, dans le cadre de la mise en place d’un cours de droit de protection des enfants, dans les écoles de formation de police et gendarmerie.
L’atelier d’Agboville qui est le 8ème du genre a été parquée non seulement par le soutien du secrétaire général de préfecture, Abion Yao, qui a exhorté les séminaristes à échanger dans la « vérité », afin que les droits et devoirs des enfants soient véritablement pris en compte sur le terrain, mais aussi, par l’appui technique et financier de l’Organisation des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).
AIP
Côte d’Ivoire: Bientôt des pelouses synthétiques et vestiaires pour les complexes sportifs d’Abobo et Yopougon, 550 millions d'investissement
La Fédération internationale de football association (FIFA) va décaisser la somme de 550 millions de francs CFA pour la rénovation de deux complexes sportifs du District d’Abidjan, a annoncé lundi, le premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Sory Diabaté, lors d’une conférence de presse, au siège de l’institution.
Il s’agit, a précisé M. Diabaté, des travaux de pose de pelouses synthétiques, de construction de vestiaires et de parkings au Complexe sportif d’Abobo-Gare à hauteur de 250 millions de francs CFA et du complexe Jessy Jackson de Yopougon pour une dotation financière de 300 millions de francs CFA. Le démarrage des travaux interviendra dans le dernier trimestre de l’année 2016, le temps de désigner les entreprises soumissionnaires et boucler les formalités administratives.
Selon le conférencier, ces travaux de réhabilitation aux standards internationaux, s’inscrivent dans la mise en œuvre des projets « Goal 6 » pour le cas d’Abobo-Gare et « Challenger » à Yopougon de l’instance mondiale du football, visant à doter les communes de terrains synthétiques pour une meilleure pratique du football.
Leur livraison dans un délai de quatre à six mois pour compter de la date du coup d’envoi, viendra combler le vide constaté dans la zone Abidjan-Nord en matière d’infrastructures appropriées pour la pratique du football. Ces deux sites pourront aussi abriter les compétitions de la FIF à savoir les rencontres de Division 3, des Divisions régionales et les tournois des jeunes.
AIP
Côte d’Ivoire : Dans le calvaire de l’axe Gagnoa-Yamoussoukro : réhabilité en 2013 et déjà impraticable (Reportage)
Bitume carrément arraché du sol par endroits, nids de poules, crevasses, l’axe Gagnoa-Oumé-Yamoussoukro, allant du Centre-Ouest au Centre de la Côte d’Ivoire, qui a subit des traitements d’appoint courant 2013, est depuis près d’un an à nouveau fortement dégradée, causant de nombreux désagréments aussi bien aux usagers qu’aux populations riveraines, a constaté l’AIP, lors d’un parcours de ce tronçon fin mars 2016.
Longue d’environ 130 km, cette voie qui se fend également d’une autre voie à partir de Kocoumbo, entre Oumé et Yamoussoukro, allant jusqu’à l’autoroute du Nord au niveau de Toumodi, est quasi impraticable.
En milieu de matinée, ce mercredi 30 mars 2016, les quelques véhicules et engins à deux roues qui s’y aventurent sont engagés dans un jeu de zigzag permanent pour éviter les trous et autres nids de poule jonchent le macadam et dont certains s’étendent sur deux voire trois mètres.
Cela, en dépit du fait que le tronçon partant du fleuve Bandama dans la sous-préfecture de Kocumbo à Yamoussoukro, ainsi que celui allant à l’échangeur de Toumodi, ont été renforcés à la faveur de la visite d’Etat du Président Alassane Ouattara dans la région du Bélier, du 11 au 14 décembre 2013.
Cet état de la voie dont le bitume est à plusieurs endroits carrément arraché du sol, a fini par obliger la majorité des usagers à se s’orienter vers d’autres axes routiers pour rallier Yamoussoukro.
Délaissée par les automobilistes
Depuis 2015, la nationale Gagnoa-Oumé-Yamoussoukro enregistre très peu d’automobilistes nationaux et même étrangers -en provenance des pays voisins pour le port de San Pedro-, selon certains usagers.
« Notre route est trop gâtée, à cause de ça tous les véhicules passent par Sinfra. Avant on se rendait facilement à Yamoussoukro où Abidjan, mais c’est devenu difficile de le faire depuis que les gens ont déserté notre route », se plaint Akanza N’Dri, planteur à la « Scierie Jacob », un ancien campement né d’une scierie coloniale, à 7 km Diégonéfla.
Coulibaly Anguissoro, planteur-commerçant à Ouikao, campement Baoulé situé à quelques encablures de la sous-préfecture de Diégonéfla, et traversé par la nationale Gagnoa-Oumé-Yamoussoukro, fait partie de ceux dont les activités connaissent une chute depuis que les véhicules utilitaires, de transport de marchandises et de personnes se font rares, du fait de
l’état de dégradation avancée de cette voie.
‘’Nous avons constaté depuis quelques mois, plus d’un an maintenant que les véhicules ne circulent pratiquement plus sur cette voie, et nous pensons que cela est dû au fait qu’elle est très dégradée et envahie par des nids de poule qui font que les conducteurs mettent beaucoup trop de temps pour aller soit à Yamoussoukro, Bouaké ou dans les pays limitrophes’’, s’apitoie pour sa part Coulibaly Anguissoro, planteur-commerçant à Ouikao, campement situé à quelques encablures de la sous-préfecture de Diégonéfla, et traversé par la nationale Gagnoa-Oumé-Yamoussoukro.
Au volant de son véhicule minicar bleu de transport en commun- communément appelé « Massa »-, qu’il vient de ranger sur le bas côté pour faire descendre un passager à Ouikao, Soumaïla Koné est un abonné de la ligne Gagnoa-Oumé-Gagnoa. Il n’a qu’un seul passager assis à sa droite dans la cabine de pilotage, en partance pour Gagnoa.
« On peut rouler deux jours, quatre jours, sans faire de recettes, parce que nous sommes toujours au garage à cause des pannes fréquentes occasionnées à nos véhicules par le mauvais état de la route », dépeint-il.
« Regardez, poursuit-il, on a beau éviter les trous on ne peut les éviter tous et on tombe dedans! Et puis, surtout sur le court tronçon Diégonéfla-Oumé, on ne peut même pas rouler à 70 km/heure, on est toujours entre la première et la deuxième vitesse, cela nous cause une perte de temps considérable, et on brûle aussi beaucoup trop de carburant’’.
Obligés de zigzaguer pour se frayer un chemin, les quelques rares automobilistes et autres usagers de cette route, notamment les conducteurs d’engins à deux roues sont régulièrement victimes d’accidents, comme l’explique Yao Magné Athanase dit Diaby, planteur à Lahouda, à une quinzaine de kilomètres de Diégonéfla.
« Les voitures nous coincent, on ne sait quoi faire. Tout à l’heure, il y a une voiture qui m’a coincé, c’est pourquoi on pousse nos vélos plutôt que de les monter pour éviter de se retrouver dans les ravins », dénonce-t-il, marchant et trimbalant son vélo par mesure de prudence.
Se disant dépité et fatigué de cette situation, sous le regard approbateur d’un autre planteur qui pousse aussi son vélo, M. Yao qui retourne au village après un tour au champ, où il est allé récolter du manioc, tient les tubercules contenus dans un petit sac de jute attaché à l’arrière de son engin à deux roues.
Sur cette ligne Gagnoa-Oumé-Yamoussoukro, le voyage, selon les chauffeurs, devient « interminable » surtout sur les 66 kilomètres qui séparent Gagnoa d’Oumé, avec une dégradation plus accentuée sur « les 21 petits kilomètres » reliant la sous-préfecture de Diégonéfla à Oumé.
La distance Gagnoa-Oumé qu’ils parcouraient en une heure de temps pendant que la route était bonne, les chauffeurs de la ligne se voient aujourd’hui contraints d’effectuer le même trajet en deux heures voire plus.
« La plupart d’entre nous ont fuit cette voie, et préfèrent désormais passer par Sinfra pour se rendre à Yamoussoukro, car le tronçon Yamoussoukro-Sinfra vient d’être réhabilité et offre un meilleur confort de circulation », dit le chauffeur de « Masa » Soumaïla Koné.
Daouda Nébié, pompiste dans une station d’essence de Diégonéfla, observe, impuissant, la situation. « Désormais, tout le monde préfère passer de l’autre côté, car on entend les gens dire qu’aller de Gagnoa à Abidjan, en passant par Oumé, c’est doublement plus long, on rencontre deux postes de péage sur l’Autoroute du nord, et de surcroît notre route s’est fortement dégradée en un rien de temps’’, affirme-t-il.
Ce jour, l’AIP a pu constater très peu de véhicule circuler tout le long de cette voie pourtant très stratégique pour la communication entre les localités des régions du Centre-ouest et du Centre du pays, et naguère préférée par les usagers voulant rallier les régions Ouest et Sud-Ouest à partir d’autres zones et vice versa.
Parti de Gagnoa à 10h 30, l’équipe de l’AIP n’a croisé qu’une vingtaine de véhicules utilitaires, de transport de marchandises et de personnes, dans les deux sens, jusqu’au « Carrefour de Gnamien Konankro », vers 17h.
L’abandon de la nationale Gagnoa-Oumé-Yamoussoukro, n’est pas sans conséquence sur les activités économiques des populations riveraines, notamment les habitants des campements, villages et villes, qu’elle traverse, ainsi que les opérateurs économiques installés dans la zone comme cette station-service.
Des activités économiques affectées
« Avant, ça marchait fort dans notre station, nos ventes étaient élevées mais elles ont chuté depuis que la voie Gagnoa-Lakota-Divo-Tiassalé-Abidjan a été réhabilitée et que par ici tout est redevenu comme si la route n’avait été réhabilitée qu’en 2013″, charge Daouda Nébié.
En effet, plusieurs de ces personnes s’adonnent à de petites activités génératrices de revenus aux abord de cette voie, à savoir la vente de produits vivriers, de fruits, de sandwichs, de jus, etc.
Aujourd’hui, son impraticabilité est mal vécue par ces populations qui éprouvent non seulement des difficultés pour se déplacer, mais voient également leurs petits commerces souffrir du manque de clients.
» Aujourd’hui, notre commerce de bananes est tombé et on n’a plus de revenus, parce que vous savez, sans route rien ne marche », se morfond Konan Massa Destin, jeune commerçant au « Carrefour de Tiégba », à une dizaine de km de Diégonéfla, et à une trentaine de Gagnoa.
Pour lui, le petit commerce florissant qui s’est développé au fil des ans sur cette route, avec les moments de pauses marqués par des transporteurs pour permettre à leurs passagers de se de se soulager ou de se dégourdir un tant soit peu les jambes, est en train de s’étioler.
« Depuis un moment, l’affluence devant nos produits est presqu’inexistante », appuie-t-il, pointant le mauvais état de la route. Une vue partagée par plusieurs femmes commerçantes assises, à l’abri de ce soleil de plomb, sous des hangars de fortune faits de bois et de feuilles de bambous.
L’une d’entre elles, dame Adou Lawy, ne cache pas son amertume. ‘’Regardez comment notre petit marché est vide. Quand les véhicules passaient par ici régulièrement, y avait beaucoup de commerçants dont des femmes, qui vendaient des produits vivriers, des fruits. Mais les gens n’ont plus le courage de venir vendre », fait-elle savoir.
« Pourtant, les commerçantes de ce carrefour s’occupaient de leurs familles avec les revenus provenant de la vente des produits vivriers. Ces femmes aidaient même leurs maris à scolariser leurs enfants, mais c’est devenu difficile’’, poursuit Mme Lawy.
Au « carrefour UAU » (Union agricole universelle), une plantation industrielle de caféiers coloniale située à neuf kilomètres d’Oumé, Colette Kambiré, sexagénaire, est assise un peu en retrait de la voie, dévorant une mangue, à côté d’une jeune fille, Hélène Koffi N’Guessan. Toutes deux vendeuses de mangues, elles s’apitoient sur leur sort.
« Ça ne marche plus ! », coupe la vielle, soutenue dans ses propos par sa jeune consœur qui, comme elle, propose aux clients des cuvettes de mangues proposées à 500 FCFA le contenu.
Selon ces deux femmes, avec ce que les commerçantes gagnent ici, elles s’occupent d’elles-mêmes, de leurs familles et scolarisent leurs enfants.
A une quarantaine de kilomètres de là, la même désolation et amertume se lit sur les visages d’un groupe de commerçantes du « carrefour de Gnamien Konankro », dans la sous-préfecture de Kocumbo.
Ici également, à l’instar de toutes les femmes qui proposent leurs produits vivriers et autres fruits aux passants à bords des voitures particulières ou des véhicules de transport en commun ou de marchandises, Konan Amoin, vendeuse d’escargots, s’attaque aux conséquences fâcheuses du mauvais état de la route sur leurs activités.
« Si c’était dans la bonne période où la route était praticable, avec le passage de plusieurs véhicules, cette cuvette ne serait pas encore remplie d’escargots à cette heure-ci », avance-t-elle, aux environs de 17 H, exhibant sa marchandise. Des propos corroborés par d’autres vendeuses aux alentours, dépitées par cette situation, dont profitent pourtant des jeunes désœuvrés qui procèdent au remblayage de certaines zones critiques de la voie, solliciter en retour un geste pécuniaire de la part des automobilistes.
Petites affaires pour les jeunes désœuvrés
Sur le long de la nationale Gagnoa-Oumé-Yamoussoukro, l’on aperçoit à plusieurs endroits des jeunes issus de campements et villages riverains s’obstiner à fermer quelques nids de poule avec de la terre rouge récupérée sur les accotements.
Tandis que certains de ces ouvriers bénévoles bouchent des tous, d’autres assurent la garde au niveau d’une barrière en bois qu’ils ont érigée, pour obliger les véhicules à ralentir à leur niveau, afin d’en profiter pour tendre la main aux automobilistes pour recevoir quelques piécettes.
De quoi renforcer le vœu essentiel des usagers et riverains de ce tronçon qui n’est autre que sa réhabilitation.
Plaidoyer en chœur pour la réhabilitation
De Ouikao (Diégonéfla) dans la région du Gôh, au carrefour de Gnamien Konankro (Kocumbo) région du Bélier, en passant par Oumé (région du Gôh), un seul plaidoyer est repris en chœur sur toutes les lèvres : la « réhabilitation rapide » de la nationale Gagnoa-Oumé-Yamoussoukro.
« Je souhaite ardemment que la route soit très vite réhabilitée, parce que se déplacer par ici est aussi compliquée », lance Adou Lawy, la commerçante « Carrefour de Tiégba », estimant que cela y va de la survie de nombreuses familles riveraines.
Certains suggèrent même que la route bénéficie d’un nouveau revêtement comme ce fût le cas au niveau de l’Autoroute du Nord, pour lui donner une longue durée de vie.
« Pour moi, ceux qui vont venir réhabiliter notre route, doivent enlever complètement l’ancien goudron pour mettre un nouveau bitume, parce que quand ils viennent et ils soudent les parties où le goudron n’existe plus, les nids de poule refont très vite surface à ces mêmes lieux, et ça ne dure pas », conseille pour sa part Coulibaly Anguissoro à de Ouikao.
« Il faut que le tonnage de ciment qu’il faut pour traiter les points critiques de cette voie soit effectivement utilisé à ça’’, propose pour sa part Sévérin Kouadio N’Guessan, agent de la Sodefor à Oumé.
Située en Afrique de l’Ouest dans le bassin du golfe de Guinée, la Côte d’Ivoire avec ses 322.462 km² de superficie, jouit d’un réseau routier de 81.996 km, dont 75.482 km de routes en terre, 6.282 km de routes bitumées, plus 232 km d’autoroutes, selon l’Agence de gestion des routes (AGEROUTE).
Mais les riverains et usagers de l’axe Gagnoa-Oumé-Yamoussoukro, se demandent encore si leurs 130 km méritent encore d’être pris en compte dans ces statistiques ; tant le grand espoir suscité en eux après la réhabilitation de cette voie en 2013 s’est très vite mué, à ce jour, en un véritable cauchemar.
AIP
Côte d’Ivoire : Oumé, nouvel Eldorado des orpailleurs clandestins (Reportage)
Considérées comme des eldorados, des localités du département d’Oumé sont prises d’assaut par des orpailleurs clandestins venant de pays divers. Nous sommes à Doka, un site situé à 10 km de la sous-préfecture d’Oumé. A quelques mètres du site, un vacarme traverse les nombreux hangars recouverts de sachets noirs. Ce vacarme provient non seulement des femmes et des hommes, jeunes et vieux qui creusent la terre mais aussi des bruits des moteurs des machines qui concassent les cailloux et de ceux qui lavent les sables aurifères pour extraire les paillettes d’or.
Koné Synali, orpailleur, emploie des jeunes au nombre de trois qui creusent à son compte la terre pour chercher l’or. Pour un trou, il doit débourser 10.000 francs CFA au propriétaire de terre. A chacun des jeunes, il paie, par jour, la somme de 5000 francs. C’est un véritable goût du risque. Car il faut attendre quatre jours, une semaine ou même un mois pour trouver de l’or. Toutefois, M. Koné explique qu’il arrive des fois où l’on peut gagner quatre millions par trou. « Il en a qui gagnent 10 millions par trou. « Quant à moi j’empoche souvent 350.000 francs ou 500.000 francs CFA par trou », révèle-t-il.
Des localités telles que Dougbafla et Doka, ont des terres aurifères qui attirent de nombreux orpailleurs clandestins. Bonikro, une autre localité de la sous-préfecture d’Oumé, l’or est exploité dans la légalité par la société Newcrest. Sur le site de Doka, des maliens, Burkinabé et ivoiriens y travaillent qui par groupe, qui de façon individuelle.
Mohamed Diguiba, de nationalité malienne travaille depuis cinq mois, sur ce site. Propriétaire d’une machine à laver du sable, il dirige un groupe de quatre personnes et gagne 20.000 francs par jour, soutient- il. Le jeune Souleymane Cissé, l’un des ses employés, recouvert de terre était en train de creuser un gros trou avec ses amis. Il est à 10 ou 11 mètres de profondeur. Mais, il faut 13 à 14 mètres pour trouver l’or. Et de renchérir, « dans ce trou, il peut avoir au moins 30 kg d’or et sont 25 personnes à le creuser », jugeant cette activité lucrative. Souleymane Cissé ne compte jamais l’abandonner, a-t-il fait savoir.
Degnimin Karim est à Doka depuis trois mois. Il reconnait avoir vendu, plus de 250 grammes d’or qui lui ont rapporté plus de quatre millions de francs CFA. Karim et ses amis creusent des trous de plus de 60 mètres pour atteindre la qualité qui rapporte les millions racontent-ils. Traoré Makan et Coulibaly Ibrahima, de jeunes ivoiriens, Sawadogo Issiaka, burkinabé, tous membres d’un autre groupe, se disent spécialisés dans la recherche de l’or. Ils rentrent par un trou et en sortent par un autre. Dahouda Ali, un malien, travaille avec trois jeunes. Il affirme avoir payé 100 millions francs CFA au propriétaire de terre afin de s’installer sur site de Doka. Il dit ne pas regretter d’avoir choisi cette activité qui lui permet de gagner sa vie.
Sidi Dimba, Diaby Moussa, tous deux maliens et Camara Sidibé, guinéen, attendent les vendeurs des paillettes d’or. Le gramme coûte 15.000 francs CFA. Ils revendent à leur tour, aux grossistes à Abidjan à 22.000 francs CFA le gramme.
AIP
Côte d'Ivoire-Attribution de la 4ème licence de téléphonie mobile : le ministère de tutelle prône la vigilance
Dans un communiqué, le Ministère de l’Economie Numérique et de la Poste appelle les opérateurs économiques à la vigilance, afin de ne pas se faire gruger par des individus mal intentionnés.
« Il nous revient que des personnes mal intentionnées, affirmant agir au nom de Monsieur le Ministre de l’Economie Numérique et de la Poste, Porte-parole du Gouvernement, contactent directement des Opérateurs Economiques qui seraient intéressés par l’attribution de la licence du 4ème opérateur de téléphonie mobile », entame le texte.
Le département ministériel dirigé par Bruno Nabagné Koné rappelle à tous les opérateurs économiques qui sont intéressés par cette opération, que les seuls interlocuteurs autorisés sont le cabinet du Ministre de l’Economie Numérique et de la Poste et l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI).
Après le retrait des licences de quatre opérateurs pour non respect des cahiers de charge, un appel est lancé pour l’attribution d’une quatrième licence de téléphonie mobile en Côte d’Ivioire, rappelle-t-on.
Côte d’Ivoire :Newcrest va exploiter une mine d’or à dans le Centre ouest
L’Etat de Côte d’Ivoire, à travers le ministère de l’Industrie et des Mines, a signé jeudi à Abidjan, une convention avec la Société Newcrest Hiré Côte d’Ivoire SA pour l’exploitation d’une mine dans le département de Hiré (Sud-Ouest, région du Lôh-Djiboua).
Les documents de cette convention conclue pour une durée initiale de 12 ans par le ministre Jean-Claude Brou et le président directeur général, Lawrence Manjengwa, avaient pour objet de déterminer contractuellement les rapports entre l’Etat ivoirien et la société d’exploitation minière, pendant sa durée de validité.
Cette convention minière définit donc les conditions générales, juridiques, financières, économiques, sociales administratives et environnementales dans lesquelles la société d’exploitation exerce ses opérations minières à l’intérieur du périmètre, ainsi que les garanties et les obligations particulières des parties.
Le PDG Lawrence Manjengwa a exprimé sa reconnaissance au gouvernement ivoirien pour l’octroi de cette mine « satellitaire » à son Groupe et a indiqué que cette convention intervenue entre les deux parties, renforcera la confiance quant à l’exploration de gisements miniers de la société en Côte d’Ivoire.
Quant au ministre de l’Industrie et des Mines, il s’est réjoui de l’aboutissement des négociations qui ont pris « assez de temps ». Il a remercié toutes les équipes qui ont travaillé à la conclusion de ce partenariat gagnant-gagnant et exhorté la direction du Groupe à étendre ses activités sur d’autres sites.
« Je souhaite que cette signature marque le départ de la mine de Hiré puisque les travaux ont déjà commencé, mais marque aussi une étape importante dans le développement du programme minier à l’Ouest du pays pour que la Compagnie contribue davantage à l’économie ivoirienne », a déclaré le ministre Brou.
L’implantation de Newcrest Hiré Côte d’Ivoire SA à Hiré porte à deux, le nombre de compagnies minières dans le département après celle de Bonikro. Ces deux entreprises généreront autour de 1 500 emplois directs, a-t-on appris.
AIP