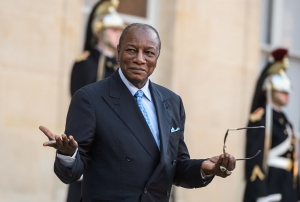La décision du candidat démocrate présumé à la présidentielle de 2020 Joe Biden de choisir la sénatrice Kamala Harris comme colistière a été accueillie avec enthousiasme par l’électorat démocrate, notamment parmi la communauté afro-américaine, alors que la presse a salué un choix “historique”.
D’un père d’origine jamaïcaine et une mère née en Inde, Harris est à la fois la première femme noire et la première femme sud-asiatique à obtenir une nomination nationale d’un grand parti politique américain.
“Joe Biden a parfaitement réussi dans cette décision”, a écrit l’ancien président Barack Obama dans un long communiqué. “En choisissant la sénatrice Kamala Harris comme prochaine vice-présidente des États-Unis, il a souligné son propre jugement et son caractère. La réalité nous montre que ces attributs ne sont pas facultatifs chez un président”, a-t-il fait observer.
Même son cloche du côté de la candidate démocrate malheureuse à l’élection de 2016, Hillary Clinton, qui a tweeté: “Je suis ravie d’accueillir Kamala Harris sur un ticket démocrate historique. Elle a déjà prouvé qu’elle était une incroyable fonctionnaire et leader. Et je sais qu’elle sera un partenaire solide de Joe Biden”.
De son côté, l’ancienne ambassadrice de l’ONU et ancienne Conseillère à la Sécurité nationale sous Obama, Susan Rice, a chaleureusement félicité la sénatrice de Californie, estimant que Mme Harris était “un leader tenace et avant-gardiste qui fera un excellent partenaire sur le chemin de la campagne”. Selon plusieurs sources, Mme Rice était la principale rivale de de Kamala Harris pour ce poste tant convoité.
Dans cette même veine, la sénatrice Elizabeth Warren, ancienne candidate à la présidentielle et qui a également été évoquée pour ce poste, Kamala Harris “sera une excellente partenaire de Joe Biden pour faire de notre gouvernement une force puissante pour le bien dans la lutte pour la justice sociale, raciale et économique.… Et j’ai tellement hâte de voir Kamala affronter Mike Pence lors d’un débat!”.
Du côté du parti républicain, la campagne Trump a qualifié Mme Harris de “testament politique de Biden” et a accusé le nouveau ticket démocrate de “céder le contrôle de notre nation à la foule radicale avec des promesses d’augmenter les impôts, de réduire le financement de la police, de tuer les emplois dans le secteur de l’énergie, d’ouvrir nos frontières et d’apaiser les dictateurs socialistes.”
Pour sa part, le président Donald Trump a déclaré mardi que la sénatrice Kamala Harris était son “choix n° 1” pour être nommée vice-présidente de Joe Biden, ne manquant pas de moquer sa candidature à la présidentielle infructueuse et se plaignant longuement qu’elle avait été “méchante” lors des audiences de confirmation au Sénat du juge de la Cour Suprême Brett Kavanaugh en 2018.
“Elle a fait très, très mal dans les primaires, comme vous le savez. On s’attendait à ce qu’elle réussisse bien. Et elle a fini juste autour de 2 % et a dépensé beaucoup d’argent”, a réagi le locataire de la Maison Blanche.
“Elle a été extrêmement méchante avec le juge Kavanaugh. … Elle était méchante à un niveau qui était juste une chose horrible (…) et je n’oublierai pas cela de sitôt. Elle a été très mauvaise dans les primaires, et maintenant elle est choisie, alors voyons comment tout cela ira”, a-t-il poursuivi.
S’il est une catégorie qui a été ravie par le choix de Harris, c’est bien celle de la communauté afro-américaine. Selon Washington Post, “la propulsion de Kamala Harris sur le ticket démocrate mardi a déclenché une vague d’émotion à travers le pays alors que les Américains ont pour la première fois vu une femme de couleur accéder aux plus hauts niveaux politiques du pays”.
“La sélection de Harris en tant que prochaine vice-présidente potentielle a été accueillie avec enthousiasme et soulagement que les femmes noires, qui constituent à bien des égards le cœur du Parti démocrate, aient enfin l’une des leurs sur le ticket national”, écrit le Post.
“Je saute de joie”, a notamment déclaré Johnnetta Cole, qui a été la première femme noire présidente du Spelman College, l’université historiquement entièrement féminine d’Atlanta. “Aujourd’hui, 401 ans après l’arrivée des premiers Africains asservis dans ce qui était alors la Virginie britannique, regardez ce qui s’est passé. Quiconque n’en ressent pas la signification, je dois demander: “Qui sont-ils? Où étaient-ils?”, rapporte le grand tirage.
“J’ai les larmes aux yeux mais la joie dans mon âme”, a réagi pour sa part la représentante démocrate Sheila Jackson Lee sur Twitter. “Je suis tellement bouleversée, car je sais que les femmes de tout le pays, les femmes de couleur et oui les femmes noires peuvent enfin voir leur statut égal dans ce pays”.
aa