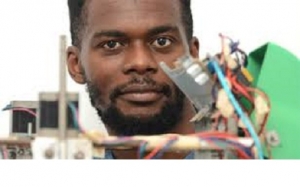Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been....
Armand Tanoh
Côte d’Ivoire : Le monitoring des prisons proposé pour prévenir la torture
L’association des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT CI) section Côte d’Ivoire fait la promotion d’un monitoring des lieux de détention pour prévenir la torture, a fait savoir, vendredi, lors d’une conférence de presse à son siège à Abidjan, son président Paul Angaman.
Il a expliqué qu’à ce propos, un séminaire-atelier a statué sur la question deux jours auparavant à Yamoussoukro et visait le renforcement des capacités des points focaux-prison de l’ACAT CI, essentiellement constitués de travailleurs sociaux des maisons d’arrêts et de correction et la société civile en matière de respect des droits fondamentaux des détenus.
Selon M. Angaman, les actions menées tous azimuts par les ONG intervenant dans le milieu carcéral, « diluent » les forces, d’où, a-t-il expliqué, la nécessité de mettre sur pied des actions coordonnées pour plus d’efficacité. « Nous avons constaté que le milieu carcéral ne va pas bien, il y a plusieurs organisations qui interviennent mais les actions sont tous azimuts. Il serait intéressant de faire un état des lieux de ces prisons pour savoir (…) qu’est ce qui est nécessaire pour mieux orienter les actions dans ce milieu », a-t-il indiqué.
Le président de l’ ACAT CI, a par ailleurs annoncé la mise sur pied à terme, d’un observatoire des lieux de détention ou de prévention de la torture, qui selon lui, constituera un système de veille stratégique du milieu carcéral. « Un rapport pourra contribuer à la mise en place d’une plate forme d’organisations intervenant dans le milieu carcéral afin d’envisager de manière synergique et structurée les actions dans ce milieu. Un observatoire des lieux de détention ou de prévention de la torture pourra ainsi ce mettre en place », a-t-il laissé entendre.
L’atelier a réuni 47 participants dont 30 points focaux des 34 maisons d’arrêts et de correction que compte la Côte d’Ivoire, un représentant de la commission nationale des droits de l’homme de Côte d’Ivoire (CNDHCI) et 16 membres de la société civile.
AIP
Côte d’Ivoire : L’ONUCI va financer trois projets communautaires à impact rapide à Vavoua
Lors de la deuxième réunion préparatoire de la 44è Journée de l’ONU qui aura lieu à Vavoua, les représentants de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) ont annoncé mercredi le financement de trois projets communautaires à impact rapide dans le département.
Ces projets concerneront les domaines de la santé, l’éducation et la jeunesse et coûteront la somme de 37,5 millions de francs CFA à raison de 12,5 millions CFA par secteur. Il s’agira, ont expliqué les envoyés de Mme Aïchatou Mindaoudou, de faire des réhabilitations et des achèvements d’infrastructures.
Tout en remerciant déjà l’ONUCI, le préfet Déhoulé Nguessan Augustin a proposé que les projets à financer atteignent une dizaine, expliquant que le département de Vavoua, déjà très vaste, reste « très en retard au niveau des infrastructures économiques » du fait de la décennie de crise.
Les femmes de Vavoua ont déjà bénéficié d’un marché de vivriers dont la construction a été entièrement financée par l’ONU-CI et qui sera inauguré lors de cette Journée, a-t-on appris.
Selon le dernier recensement général de la population et de l’habitat (RGPH 2014), le département de Vavoua est peuplé de 409 912 habitants pour une superficie de 6 168 km², avec trois sous-préfectures et une commune.
AIP
Côte d'Ivoire : Le retour l’Ecole supérieure interafricaine d’électricité en projet
Le Premier ministre, Daniel Kablan Duncan a effectué, vendredi, une visite au Centre des métiers de l’électricité (CME) de Bingerville, en vue d’évaluer la possibilité du retour de l’Ecole supérieure interafricaine d’électricité (ESIE) sur son ancien site.
« Sur un ensemble de 45 hectares, une partie donnée à la FIF et l’autre à l’Université. Notre souhait, c’est de voir s’il n’y a pas une possibilité de développer la nouvelle école de l’ESIE sur son ancien site. Nous nous demandons s’il peut y avoir une synergie entre ces deux écoles, à savoir le CME et l’ESIE », a déclaré M. Duncan, qui avait à ses côtés le ministre du Pétrole et de l’énergie, Adama Toungara, pour cette visite.
Selon le Chef du gouvernement, le secteur de l’électricité est un domaine de plus en plus « porteur » pour les pays africains. Et pour la Côte d’Ivoire qui ambitionne de doubler sa production énergétique de 2 000 Mw à 4 000 Mw, il faut une école de référence pour former des cadres supérieurs compétents tels que les ingénieurs de conception et d’application.
Il a ajouté qu’un projet présenté par le Ministre Toungara, a été déjà adopté en Conseil des ministres dans le cadre du plan national de développement (PND 2016-2020)et le gouvernement n’attend plus que les conclusions du travail technique, afin d’être situé sur la mise en œuvre de ce projet sur le futur site agréé.
AIP
Côte d'Ivoire : Abidjan abrite la 119ème session de l’Organisation internationale du café en septembre
En mission en Côte d’Ivoire dans le cadre d’un atelier relatif à la création d’un fonds de développement du café intitulé Mécanisme africain du Café, le directeur exécutif de l’Organisation internationale du café (OIC), Roberio Oliveira Silva, a été reçu en audience par le ministre du Commerce, Jean Louis Billon, qui était assisté pour la circonstance par Aly Touré, Représentant Permanent de la Côte d’Ivoire auprès des organisations des produits de base.
Lors de cette rencontre tenue le 28 avril, M. Roberio a indiqué au ministre être venu remercier les autorités ivoiriennes pour leurs contributions à l’émergence d’une économie caféière durable. Il a également demandé à M. Billon de transmettre sa gratitude au Président Alassane Ouattara, pour le soutien constant que la Côte d’Ivoire apporte à l’OIC.
Ensuite, les deux personnalités ont échangé sur la 119ème session du Conseil de l’OIC qui devrait se tenir à Abidjan en septembre 2017. C’est la première fois que la Côte d’Ivoire accueillera cette importante réunion de l’Organisation internationale du café.
Quant au ministre du Commerce, il a félicité le directeur Exécutif pour le travail abattu au profit des producteurs et consommateurs de café. Il a réitéré la disponibilité de la Côte d’Ivoire à soutenir toutes les initiatives relatives à la durabilité du café, en vue d’une amélioration des revenus des producteurs.
AIP
Le gouverneur de la BCEAO distingué par le CAMES
Lors de la cérémonie de clôture de la 33ème session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES à Dakar, le gouverneur de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), Tiémoko Meyliet Koné, a été élevé vendredi, au rang de Commandeur de l’Ordre International des Palmes Académiques (OIPA) du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES).
Le CAMES honore ainsi le gouverneur ivoirien pour son action en faveur de « la promotion de la formation et de la recherche », surtout dans le domaine financier et économique. « M. Tiémoko Meyliet Koné (…) a mérité l’attention du Conseil à cause de son implication à la promotion de la formation et de la recherche dans son secteur d’activité », a justifié le rapporteur du Conseil lors de la présentation des récipiendaires.
La BCEAO assure la tutelle du Centre africain d’études supérieures et de gestion (CESAG). En matière de recherche, on peut dénombrer la mise en œuvre de quelques initiatives sous son impulsion notamment le Prix Abdoulaye Fadiga pour la promotion de la recherche économique, et la Revue économique et monétaire dont le comité scientifique est composé d’universitaires et de chercheurs de haut niveau provenant du monde entier.
Il y a aussi, l’organisation des colloques BCEAO, Universités et centres de recherches considérés comme des creusets d’échanges approfondis entre universitaires et professionnels de la monnaie et de la finance, a ajouté le Conseil.
Outre le gouverneur de la BCEAO, plusieurs autres personnalités ont également été honorées par le Conseil de l’Ordre des Palmes Académiques du CAMES pour leurs actions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche.
À ce titre, l’ancien président de la République du Sénégal, et ancien secrétaire général de l’organisation internationale de la Francophonie (OIF), Abdou Diouf, a été fait Grand-croix de l’OIPA. Les ministres de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du Sénégal et du Togo, respectivement Mary Teuw Niane et Octave Nicoué Broohm ont été élevés au rang de Commandeur de l’Ordre International des Palmes Académiques. Le vice-recteur en chargé du contrôle interne et de l’évaluation de l’Université Yaoundé 1, Joly Assako Assako, a reçu le grade de Chevalier de l’OIPA.
Les distinctions de l’Ordre international des Palmes Académiques du Cames ont été créées à Abidjan, en 2002. Elles sont composées des grades suivants: Chevalier, Officier, Commandeur ; et de deux dignités : Grand-officier et Grand-croix. Au total, 353 chevaliers, 87 officiers, 35 commandeurs et 20 Grand-croix ont été décernés par le Conseil de l’OIPA du CAMES.
AIP
Investissement en Côte d’Ivoire : Clin d’œil de Ouattara au chocolatier algérien BAFI
Un clin d’oeil a été fait par le président ivoirien, Alassane Ouattara, au groupe BAFI, en vue de venir installer une unité de fabrication du beurre de cacao en Côte d’Ivoire.
Lors d’une récente visite d’Etat de quatre jours en Algérie, le chef de l’Etat a invité le chocolatier BAFI dans la ville de Constantine. A cette occasion, le président ivoirien n’a pas manqué d’inviter les dirigeants de cette entreprise à venir s’installer dans son pays.
Il les a alors encouragé à installer, dans un premier temps, une usine qui pourrait fabriquer du beurre de cacao et ultérieurement du chocolat.
Le président de la République qui a, durant son séjour, rencontré les autorités algériennes, a invité également les entreprises de ce pays à travailler en partenariat avec les entreprises ivoiriennes, en vue de développer, de redynamiser et d’intensifier les échanges commerciaux entre la Côte d’Ivoire et l’Algérie jugés encore faibles.
Les échanges commerciaux entre la Côte d’Ivoire et l’Algérie ont été, en effet, estimés à près 131,2 millions de dollars US (environ 75 milliards de francs CFA) en 2015, rappelle-t-on.
En plus des accords signés dans les domaines agricoles, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, le numéro un ivoirien a demandé aux entreprises algériennes de venir investir en Côte d’Ivoire, notamment dans les mines, l’énergie, les infrastructures, l’agroalimentaire et le transport.
Armand Tanoh
Interview / Séname Koffi (Jeune entrepreneur togolais) : "Mon ambition, concilier l’architecture et l’anthropologie via les IT dans la construction des villes africaines"
Né au Togo où il a fait ses études primaires et secondaires sanctionnées par le Baccalauréat (BAC II), Koffi Sénamé Agbodjinou est un chercheur indépendant en architecture et anthropologie.
Après deux années de formation à l'Université de Lomé, il s'est rendu en France pour poursuivre ses études. Au cours de ces formations, il s'est intéressé au design, à l'histoire de l'art, à l'architecture notamment, et poursuit actuellement des études en anthropologie.
Envie de pousser la jeunesse africaine à réaliser ses rêves, par des projets à faire développer l’Afrique, ce Togolais est le créateur du WOELAB (espace de démocratie technologique et modèle inédit d’incubateur de proximité).
Dans cette interview donnée à La Diplomatique d’Abidjan (LDA), il explique mieux son projet ; sa vision pour le développement de l’Afrique et ses actions menées au sein de son pays le Togo.
La Diplomatique D’Abidjan (LDA) : Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?
Séname Koffi : Je fais de la recherche en indépendant au carrefour de l’architecture et de l’anthropologie avec une plateforme : "L’Africaine d’architecture". L’Africaine est à l’origine d’une réflexion sur la transformation vernaculaire de la ville grâce aux technologies de l’information (IT), que nous testons à Lomé. J'ai donc aussi depuis 2012, ce petit engagement social autour du numérique avec l’approche #LowHighTech et la naissance du premier tech-hub togolais WoeLab. Je suis le principal animateur et sponsor de ce lieu d’innovation où nous essayons de développer tous types de projets tech pouvant impacter positivement l’environnement d’un rayon d’1km autour.
LDA : Parlez-nous de votre projet WoeLab !
Séname Koffi : Un peu fablab, un peu coworking space, un peu startup-studio, il faudrait voir WoeLab comme une sorte de maison de quartier 2.0. C’est un espace expérimental élaboré sur le modèle du “enclos d’initiation” et pour avoir en contexte urbain une fonction similaire de ce type de structure dans la société organique et de tradition. En clair c’est un dispositif partagé où des jeunes grâce à une astreinte au partage découvrent et réalisent leur potentiel en impulsant, en communauté, des projets. Nous portons les idées les plus intéressantes au statut d’entreprise. Une douzaine de startups ont ainsi été prototypées. WoeLab est au service d'une vison urbaine (HubCité) dans laquelle la figure qui a l'initiative dans la production de la ville n'est plus le décideur, l'architecte ou le planificateur... mais l'entrepreneur. Qualité que le contrat du Lab est de démocratiser.
LDA : C’est par vos propres moyens que vous avez commencé ce projet ? Si oui expliquez- nous comment avez-vous eu des fonds pour commencer le projet ?
Séname Koffi : Le Lab est autofinancé dès ses origines et le demeure après 4 années d’existence. C’est un choix que nous avons fait pour le symbole et pour jouir de l’indépendance nécessaire à déployer pleinement la vision qui était la mienne. Il faut dire que cette sorte de virilité marchait tout à fait avec l’Ethique " Hacker "croisé avec ce sens paysan du concret qui forme notre logiciel. En terme de vrai impact, pour moi, tout ce que pourrait apporter ce projet n’est rien à côté de ce qu’il puisse participer de déprogrammer le regard qu’on porte sur l’Afrique en incarnant un certain refus de l’aide. Cela est contre-intuitif mais il me semble que ce sera un fondamental de la modernité africaine. Nous finançons principalement sur fonds propres mais le programme startup #siliconvilla est appelé petit à petit à prendre le relais.
LDA : Depuis le projet lancé, combien de jeunes qui répondent à l’appel de l’ « entrepreneuriat » au Togo ?
Séname Koffi : Au Togo, à peu près 3 jeunes sur 4 que vous pourriez identifier dans cette scène-tech en maturation, ont fait leurs armes à mes côtés ou ont été directement ou indirectement nourri par l'expérience WoeLab. Ce n’est pas la quantité qui compte en vrai, dans la logique écosystème qui doit être celle d’un catalyseur. Et là, ce qu’il faut dire c’est que nous échouons bien trop souvent encore à prévenir les réflexes d’appropriation, de jouissance immédiate et les tentations à la réalisation personnelle au détriment du groupe. Or il nous semble que c’est sur un modèle particulier d’entrepreneuriat sur le modèle du “commun” que l’Afrique peut construire une contribution de poids à la culture startup.
LDA : Citez-nous des projets novateurs lancés par quelques jeunes ?
Séname Koffi : L’approche que WoeLab explore est celle de l’aventure collective et les projets nous mobilisent toujours dans cette optique “partagé”. Ce qui est le premier de leur caractère novateur. Nous avons impulsé par exemple, pour citer ce qui nous préoccupe le plus ce moment, deux projets assez avant-gardistes de transformation systématique de la ville par l’entrepreneuriat: SCoPE pour la collecte et le tri sélectif smart des déchets et Urbanattic sorte d’AMAP 2.0, pour de l’agriculture urbaine connectée.
LDA : Pourrais-t-on dire que le TOGO se positionne comme le HUB technologique avec toutes ses initiatives?
Je ne sais pas. Cela serait justifié en tout cas. Et je crois savoir que c’est l’ambition des décideurs.Cela ne serait pas compliqué à réaliser en tout. Nous avons des éléments qui jouent en notre faveur dont le tropisme: la taille du pays, la situation, le fait que ce serait un carrefour de plusieurs populations etc…Il s’agit de penser la chose technologique et de dégager une vision.
LDA : Pensez-vous élargir ce projet à l’ensemble de l’Afrique ? Si Oui, quels sont les pays que vous visez pour installer de prochains « WOLEAB » ?
Séname Koffi : WoeLab n’a pas vocation à répliquer en dehors du territoire HubCité. C’est à tous points de vue une expérimentation. Ceci dit j’accompagne à différents niveaux plusieurs projets locaux, la plupart portés par de très jeunes gens, de montage de lieux d’innovation au Mali, au Congo, au Nigeria, au Cameroun, etc.
LDA : Avec une formation en architecture et anthropologie, quelles sont les actions que vous entreprenez dans ce domaine dans votre pays ?
Séname Koffi : Je n’ai malheureusement pas la chance de m’exprimer beaucoup directement dans mes domaines d’origine. Je pense que ce que je pourrais proposer quelque chose qui est du sens pour le Togo et l’Afrique. Nous allons essayer dans les mois qui viennent de faire sortir du sol un foyer d’accueil pour orphelins, entièrement en technique nubienne. C’est essayer de mener un projet jusqu’au bout sans qu’il y ait trop de déperdition dans l’éthique initiale.
LDA : La Côte d’Ivoire est aussi un pays où le gouvernement ivoirien met l’accent sur l’emploi des jeunes, l’entreprenariat des jeunes, par des agences et fonds destinés aux projets de jeunes. Avez-vous des modèles que vous connaissez en Côte d’Ivoire dans le domaine de l’entreprenariat ?
Séname Koffi : Je ne connais pas dans le fonds la scène ivoirienne. J’ai eu le plaisir de rencontrer Jean Delmas EHUI en 2012. Il incarne presqu’à caricature ce qu’en mon sens peut être l’engagement d’un africain dans le mouvement startup. On a une vision particulière de la réussite en Afrique. C’est perçu comme ce qui doit nous arracher de notre contexte où nous couper du terreau d’origine. Et on considère qu’on a réussi quand, par exemple, dans un environnement où tous vont à pied, on roule en voiture ou qu’on s’est mis à ne plus manger tout à fait comme ceux qui nous entourent. Ce qu’il y a de presque jubilatoire pour moi, dans la culture startup, c’est qu’elle peut frapper de caducité cette façon de voir archaïque. Et demain on pourrait se surprendre à considérer que ceux qui ont le mieux réussi sont ceux qui tout en le tirant vers le haut ont réussi à se fondre en leur contexte. Cela suppose que dès la base qu’on entretienne cette intimité radicale avec..., que cela soit même le fondement modèle économique bien compris et donc de la garantie sociabilité de son idée. En ce sens Delmo est le prototype du startuper africain.
LDA : Quelles sont vos projets à court, moyen et long terme ?
Séname Koffi : Mon approche est assez générative. Il n’y pas d’objectif gravé dans le marbre. Il faut seulement un déterminatif (le motif), un déterminant et une détermination. Quand vous avez cela ce sont les conditions et la tension qui vous prescrivent le ‘next step’. Aujourd'hui les conditions inclinent principalement vers une première itération du modèle et un besoin de témoigner. Je travaille donc au lancement de WoeLab Prime et à un petit ouvrage qui j'espère sortira bientôt.
LDA : Des prix remportés grâce à ces actions menées au Togo ou ailleurs ?
Séname Koffi : Quelques-uns, oui. En 2010, j’ai reçu un trophée "Cœur d’immobilier", qui devait déclencher le projet d’extension, avec un espace pour la femme de la cellule d’obstétrique d’un petit hôpital rural à Mao au Tchad ; mais cela n’as pas vu le jour.
LDA : On change de sujet ! Etes-vous marié ? Des enfants ?
Séname Koffi : Oui je m’occupe aussi d’un foyer et ce n’est pas le projet dont je suis le moins fier.
LDA : Un mot à la jeunesse ivoirienne qui vous lis et à l’ensemble de la jeunesse africaine
Séname Koffi : Afrique !
Interview réalisée par Nadège Koffi
Côte d’Ivoire-PND 2016-2020 : Découvrez les futures routes qui couvriront le sol ivoirien
La Côte d’Ivoire entre de plus en plus dans la phase active des projets du second mandat du président Alassane Ouattara, réélu pour cinq ans en octobre 2015. Pour ce faire, le pays qui entend atteindre l’émergence d’ici 2020 avec des investissements à hauteur de 30 000 milliards de FCFA, est en pleine préparation du Groupe consultatif prévu à Paris ce mois de mai 2016 pour récolter quelque 4000 milliards auprès des bailleurs de fonds et partenaires privés.
Entre autres projets de ce Plan de développement 2016-2020 (PND 2016-2020) élaboré par le gouvernement ivoirien, les routes occupent une place de choix. En effet, de nombreux projets de construction de routes sont prévus dans cette période, dont certains travaux ont déjà démarrés.
La Diplomatique d’Abidjan (www.ladiplomatiquedabidjan.net) qui a pu consulter des documents de présentation des grands projets du PND 2016-2020 vous présente quelques projets routiers stratégiques qui verront le jour dans le cadre cette vision.
Concernant les projets autoroutiers, l’on note en bonne place la construction des autoroutes Yamoussoukro-Bouake à 215,499 milliards FCFA, et Abidjan-San Pedro à 740 milliards mais qui débutera par la section Abidjan-Dabou dont le financement est déjà acquis.
A cela, s’ajoutent les bitumages des axes Agnibilékrou- frontière Ghana (21 milliards, Sassandra-Gagnoa (81,600 milliards), Divo-Guitry-Cotière (57,200 milliards) Odienné-Samatiguila-frontiere Mali (72,5 milliards), Tiébissou-Sakassou-Béoumi (44,400 milliards).
Prévus également au tableau de bord du PND 2016-2020, le bitumage des axes Samatiguila- Minignan-frontière Guinee (35 milliards), Bouna-Vonkoro-frontiere Ghana (18 milliards), Aprompronou-Amoriakro-Comoé (25,200 milliards), Ouaninou-Touba (13,800 milliards), Korhogo-M'bengue-Niellé (66 milliards).
A l’ouest, les villes de Guiglo et de Taï accueilleront la construction de trois ouvrages d’art (Pont, échangeurs, 32,4 milliards), quand à l’Est, l’on assistera au bitumage de route Bondoukou-Soko-Frontière Ghana (7 milliards de Fcfa).
Aussi, le bitumage des routes Sifié-Man (63,600 milliards) et Séguela-Touba (79,800 milliards), Mankono-Zuénoula, Mankono-Tiéninggoué (32 milliards, déjà en cours) et Mankono-Séguéla, est prévu.
Armand Tanoh
Côte d'Ivoire-INTERVIEW Pr Bléou Martin : « L’idée de Ouattara n'est pas de modifier la constitution mais d'adopter une nouvelle Constitution »
Invité de la rédaction de l’AIP, à son forum d’échange et d’information, baptisé « La Tribune de l’AIP, le professeur des universités, Martin Djézou Bléou, titulaire de la chaire de droit public, s’est prononcé sur l’un des sujets brûlants de l’heure : le référendum constitutionnel qu’a évoqué le président de la République, à l’occasion de son traditionnel message du Nouvel An à la nation, le 31 décembre 2015.
Deuxième constitutionnaliste ivoirien, après le professeur Francis Romain Vangah Wodié, l’ancien ministre de la Sécurité, a élaboré sur le thème : « La révision de la Constitution (ivoirienne) : pourquoi et comment ? »
AIP : Dans son traditionnel discours à la nation, le 31 décembre 2015, le chef de l’Etat ivoirien (Alassane Ouattara) annonçait, pour 2016, la tenue d’un référendum constitutionnel. Dans votre exposé introductif, Professeur, vous indiquez quatre circonstances qui peuvent amener à ce projet ; il s’agit d’une démarche pour l’appropriation et/ou la préservation du pouvoir par l’exécutif, de réponses à des dispositions jugées polémiques ou tendancieuses contenues ou identifiées comme telles dans la Loi fondamentale, qui peuvent l’y amener, de même il s’agit de juguler une crise politique majeure. Alors, quel est le schéma, selon vous Professeur, qui se profile pour le projet annoncé par le Président de la République?
Professeur Martin D. Bléou : Dans la situation présente, rien n’indique que la voie de la révision (de la Constitution) sera empruntée. Si l’on s’abandonne aux propos tenus par le président de la République, et que j’ai rapportés, l’idée qui l’habite, d’après les termes qu’il a utilisés et qui sont chargés de sens qu’on ne doit pas trahir, ni travestir, est celle de faire adopter par référendum une nouvelle Constitution, qui induirait de facto, une troisième République, fondée sur une nouvelle Constitution. Vous l’avez entendu, il a parlé d’une nouvelle Constitution ; il a été plus explicite encore en parlant d’une troisième République.
La révision de la Constitution ne peut, en aucune manière, conduire à passer d’une République à l’autre. L’on ne passe d’une République à l’autre que lorsqu’on change de Constitution, et que le principe républicain contenu dans la Constitution précédente, antérieure, défunte, se trouve reconduit dans la Constitution nouvelle. Le principe contenu dans la Constitution ancienne est reconduit. On passe d’une République à une autre République, de la première République à la deuxième, de la quatrième à la cinquième République, en France.
Voyez-vous, par exemple, si vous prenez la Constitution ivoirienne du 3 novembre 1960, et que vous la lisez, vous vous rendrez compte, dès les premières lignes, que l’Etat ivoirien proclame son attachement à la démocratie, et affirme bâtir une République ; c’est une affirmation que l’on retrouve dans la Constitution actuelle. Ce qui veut dire que le pouvoir politique est appréhendé ou su comme la chose de tous ; la Res publica, c’est-à-dire la chose de tous, la chose publique.
De la Constitution du 1er août 2000, l’on retrouve affirmé ou réaffirmé ce principe ; donc, on passe là d’une République à une autre. Toutefois, la révision de la Constitution n’emporte pas passage d’une République à une autre ; on demeure dans la même République, mais il s’agit d’une République reformulée, repensée, modifiée, rajeunie, et la Constitution qui porte cette armature, cette construction, conserve sa date, garde son identité.
«La bonne formule serait de mettre en place un comité ou une commission comprenant les différentes composantes du corps social, afin que ce qui est pensé et établi procède de la volonté générale(…) »
AIP : En tout état de cause, Professeur, à ce stade actuel de l’évolution de la Côte d’Ivoire, faut-il envisager la révision ou se doter d’une nouvelle Constitution ?
Pr Bléou : Au risque de ne pas vous satisfaire, je signale qu’il ne m’appartient pas de répondre à une telle préoccupation ?
AIP : Mais, en tant que spécialiste…
Pr Bléou : Tout dépend des objectifs poursuivis. Je donnerai, la semaine prochaine, à Bouaké, une conférence inaugurale, à la faveur de la rentrée solennelle des Masters, et j’interviendrai sur la question de la troisième Républiques sur le thème « Interrogations et réflexions autour de la troisième République (ivoirienne) ».
Si l’on vise l’institution d’un poste de vice-président, alors, on reste dans le système républicain. Si, au contraire, comme le laissent entendre une certaine presse qui explique que le projet vise à instituer au profit du président de la République la possibilité de dissoudre l’Assemblée nationale, là c’est différent ! L’on n’est plus en régime présidentiel ; on passe, dès lors, du régime présidentiel à un autre régime. Et cela s’accommode mal avec le socle sur lequel l’actuelle Constitution repose. On passe d’un régime à un autre. Et le bon sens commande que, dans ce cas-là, il y a lieu d’aller vers l’établissement d’une nouvelle Constitution. Donc, tout dépend de ce que l’on se propose de faire, de ce que les politiques veulent faire.
AIP : Sous le rapport de votre analyse, l’on peut penser que le projet vise alors une République…
Pr Bléou : On y va bien sûr, avec le peuple tout entier, à tout le moins, avec les forces socio-politiques, et comme je l’indiquais à l’occasion d’une formation que j’ai dispensé à une organisation de société civile, l’établissement d’une nouvelle Constitution, comme la révision de la constitution existante, ne doit pas être l’affaire d’un groupuscule, un camp, un clan, une partie du corps social ; parce que cela relève de l’évidence, la Constitution, c’est l’affaire de tous, c’est le contrat social, c’est ce qui nous lie, nous rassemble, nous met ensemble ; son établissement doit faire intervenir tout le monde !
Autant que sa modification, compte tenu de ce qu’elle est appelée à s’appliquer à tous. L’on ne peut pas entendre, dans ce cas-là, que quelques-uns fabriquent ou modifient le texte, et que le texte s’applique à tous. Où serait alors la liberté des autres ? Mais, je crois que la bonne formule serait de mettre en place un comité ou une commission comprenant les différentes composantes du corps social, afin que ce qui est pensé et établi procède de la volonté générale, étant entendu que le texte est appelé à s’appliquer à tous, à refonder la société, à doter l’Etat d’un nouveau contrat social.
AIP : Professeur, vous souligniez, entre autres facteurs pouvant incliner vers ce projet, les circonstances. Alors, aujourd’hui, pensez-vous que des contingences nouvelles incitent à se doter d’une nouvelle Constitution, si l’on considère que l’article 35, objet de controverse, ne fait plus de fixation ?
Pr Bléou : Je ne sais pas s’il m’appartient de les énoncer ; mais, je pense que l’on peut envisager de diluer le pouvoir exécutif en faisant en sorte que le président de la République ait une partie du pouvoir exécutif et le gouvernement une partie, afin que la vie politique soit vivante, et le gouvernement réponde de ses actes devant la représentation nationale, devant le peuple, par le biais, par la médiation des députés. C’est ce qui me vient à l’esprit, à l’instant, mais l’on peut envisager autre chose !
AIP : L’on reproche souvent aux Constitutions, héritées de la Constitution française dans l’espace francophone, d’accorder trop de pouvoir au président de la République. Que proposeriez-vous, en tant que constitutionnaliste, eu égard à l’histoire récente de la Côte d’Ivoire, que faut-il concrètement pour améliorer les choses ?
Pr Bléou : Compte tenu de la grande tension et des déchirures que provoque l’élection présidentielle, et qui focalise l’attention de tous, je pense que l’on pourrait réduire les tensions en envisageant de réorganiser le pouvoir politique, par la mise en place d’un régime politique autre, tendant à la redistribution du pouvoir, et faisant en sorte que le président de la République ait une partie du pouvoir exécutif et le gouvernement une autre. Ce serait, alors, un régime soit parlementaire, soit semi-parlementaire, semi-présidentiel ou mi-présidentiel, ou bien, mi-parlementaire, un régime à la française ou à la britannique et, dans ce cas-là, le chef de l’Etat n’aurait pas véritablement de vrais pouvoirs, mais jouerait un rôle de magistère moral, d’influence morale.
Reste que je demeure favorable à la formule qui tendrait à la redistribution du pouvoir au sein de l’exécutif, entre le Président et le Gouvernement, de sorte à rendre ce dernier responsable devant le Parlement. C’est vivant, et cela permet à la représentation nationale de contrôler, au nom du peuple, le Gouvernement, l’action gouvernementale, l’action politique. A l’heure actuelle, il n’y a pas de moyen de contrôle avant la fin du mandat (qui est de cinq ans). Or, avec le régime que j’énonce, l’on peut contrôler, à tout moment, à travers la mise en œuvre de la responsabilité gouvernementale.
«(…) Si, c’est pour la Côte d’Ivoire, je le ferais, mais la décision ne m’appartient pas ! »
AIP : En tenant compte du contexte ivoirien, quelle pourrait être le modèle de Constitution le mieux pour la Côte d’Ivoire ?
Pr Bléou : Une bonne Constitution, c’est celle qui préserve la paix, une Constitution en laquelle toutes les composantes du corps social se retrouvent, et qui est un texte produisant la paix ; c’est cela une bonne Constitution.
AIP : Dans l’hypothèse que le processus est enclenché, et que le Parlement est saisi, est-ce qu’il ne peut être frappé de doute ou de suspicion, dès lors que l’Assemblée nationale est majoritairement contrôlée par la mouvance présidentielle ?
-Pr Bléou : C’est la raison pour laquelle, en amont, il y a un travail à faire ; il faut le consensus, que s’accordent les différentes forces sociopolitiques, et je ne dis pas politiques, parce que l’affaire n’intéresse pas que l’homme politique ; c’est l’affaire de tous, c’est la raison pour laquelle je parle des forces sociales.
Le consensus doit se dégager sur le contenu du texte, et lorsque ce consensus est obtenu, le texte peut suivre son parcours jusqu’à sa transformation en acte juridique. Il faut le consensus d’abord, sinon le texte apparaîtra comme imposé par un camp à tous ; ce qui est anormal, ce qui est contraire à la démocratie, aux exigences démocratiques ; en démocratie, ne doivent s’imposer ou s’appliquer à tous que les règles voulues par tous…
*AIP : De façon concrète, si l’on devrait avoir une nouvelle Constitution, comment pourrait-elle faire entrer la Côte d’Ivoire dans une stabilité durable ?
-Pr Bléou : Je n’ai pas de réponse sur le fond, mais sur la forme, la manière. Selon moi, l’on doit s’accorder sur un consensus minimal. Dès lors que les forces sociales et politiques se retrouvent et s’accordent sur le contenu du texte, tous adhéreront au texte ; tous accepteront l’application qui sera faite du texte, et cette application ne sera pas source de conflit (…)
*AIP : Accepteriez-vous de conduire un comité ou une commission mise en place à cet effet ?
-Pr Bléou : Il ne m’appartient pas de prendre une telle décision ; je ne sais pas, j’ai envie d’enseigner, de réfléchir, mais en ce qui concerne votre question, je ne sais pas. Si c’est pour la Côte d’Ivoire, je le ferais, mais la décision ne m’appartient pas !
Interview réalisée Kouassi Assouman, Traoré Mamadou avec la collaboration de Ange Hermann Gnanih, sous la coordination de Fousseni N’Guessan
La BAD soutient le « Plan Sénégal Emergent »
Une délégation ministérielle du Sénégal conduite par Amadou Ba, ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, s’est rendue mardi au siège de la Banque africaine de développement (BAD), à Abidjan, en vue de renforcer la coopération avec l’institution panafricaine.
Dans son mot de bienvenue, le Président de la BAD, Akinwumi Adesina, a dit l’exemplarité de la coopération avec le Sénégal, avant d’indiquer que la BAD soutiendra dans les années à venir le développement du Sénégal à travers une approche intégrée des pôles de développement agro-industriels, la promotion de l’emploi et de l’entreprenariat agricole, l’amélioration du cadre de vie en milieu rural, l’accès à l’eau et à l’électricité, la desserte intérieure, et la promotion de l’intégration régionale.
Quant au ministre Ba, il a loué la flexibilité de la Banque qui a permis de prendre en compte dans la revue à mi-parcours de son Document Stratégie Pays (DSP) 2011-2015 les nouvelles priorités du Sénégal. Confirmant ainsi que la BAD est un partenaire stratégique pour la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent (PSE).
Le portefeuille actif de la BAD au Sénégal compte 23 opérations pour un montant global de 727,46 millions de dollars US. Depuis octobre 1972, début des opérations de la BAD au Sénégal, la BAD a approuvé environ 94 opérations pour un montant cumulé de près de 1,97 milliards de dollars US, soit plus de 1 200 milliards de FCFA.
Le Gouverneur de la BAD était accompagné des ministres des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement ; de l’Hydraulique et de l’Assainissement ; de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction Citoyenne ; et du Secrétaire d’Etat au Réseau Ferroviaire.
AIP