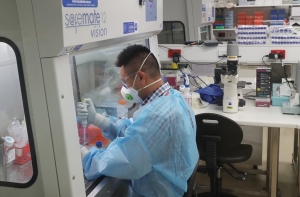Le Maroc a toujours fait part de son engagement pour une action arabe commune, une coordination et des consultations sérieuses, selon une nouvelle dynamique qui conduit à l’émergence d’un partenariat de développement qui permet aux pays arabes de profiter des opportunités offertes par les forums de la Ligue des États arabes avec les blocs régionaux d’autres pays leaders.
Pour atteindre cet objectif, le Maroc n’a cessé d’appeler à l’établissement d’un partenariat arabe basé sur un investissement optimal des potentiels de la région dans tous les domaines, pour réaliser le développement et l’épanouissement économique arabe.
Le Maroc a également œuvré pour surmonter toutes les tensions dans la région arabe, dans un cadre d’équilibre et d’objectivité, pour faire prévaloir un esprit de tolérance et de dialogue positif et ce dans l’intérêt de la région et de sa stabilité.
À cet égard, le Royaume, lors de toutes les réunions axées sur les crises arabes, n’a pas hésité à souligner la nécessité d’éviter toute ingérence dans les affaires intérieures des pays arabes et de respecter les rapports de bon voisinage, afin de trouver un terrain d’entente garantissant les intérêts des pays et des peuples de la région et ouvrant de nouveaux horizons pour la coexistence.
Ainsi et à l’occasion de tous les forums arabes, régionaux et internationaux, le Maroc a réitéré son soutien continu au peuple palestinien et à ses causes justes .
La position marocaine découle de la ferme conviction du Royaume, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods, quant à la justesse de la cause palestinienne qui demeure une question centrale à l’ordre du jour de l’ action arabe commune.
Dans ce sens et lors de toutes les réunions de la Ligue arabe, au Caire, le Maroc a réaffirmé son soutien aux frères palestiniens pour garantir leurs droits, dont celui portant sur l’édification d’un État indépendant et viable.
Durant la 153e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel, tenue le 4 mars dernier dans la capitale égyptienne, le Maroc a ainsi réitéré sa ferme solidarité avec le peuple palestinien pour défendre sa juste cause et la nécessité de ne pas porter atteinte au statut juridique de la ville sainte.
Au cours de cette réunion, le Royaume a affirmé son souhait de relancer une dynamique de paix constructive visant à trouver une solution réaliste, juste, durable et viable pour mettre fin au conflit israélo-arabe.
Il est clair que la position du Royaume est en harmonie avec la présence de la cause palestinienne, y compris la question d’Al Qods, en tant que priorité dans la conscience de toutes les composantes du peuple marocain.
Et “l’Appel d’Al Qods”, signé par SM le Roi, président du Comité Al Qods, et le pape François, visant notamment à garantir la pleine liberté d’accès dans cette ville sainte aux fidèles des trois religions monothéistes et le droit de chacune d’y exercer son propre culte, n’est qu’un exemple parmi d’autres qui reflète la position sincère du Royaume à l’égard de la juste cause du peuple palestinien.
En outre, le Parlement marocain, avec ses deux chambres, a soutenu en permanence la lutte du peuple palestinien dans divers forums parlementaires régionaux et internationaux, ainsi qu’au niveau des relations diplomatiques parlementaires, tant bilatérales que multilatérales.
En ce qui concerne la question libyenne, le Maroc a réaffirmé que la sortie de la crise dans ce pays maghrébin ne devait pas être envisagée par une solution militaire, mais plutôt par une solution politique globale, sous les auspices des Nations Unies, acceptée par les parties libyennes et au service du pays et de son peuple.
S’exprimant lors d’une réunion virtuelle du Conseil de sécurité sur la Libye, tenue la semaine dernière, le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Nasser Bourita, a fait part de “la préoccupation, la déception et l’appel à la mobilisation” du Maroc face à la détérioration de la situation en Libye.
La position du Royaume sur la crise libyenne s’inscrit dans le cadre de sa vision constante contre l’instrumentalisation diplomatique et la récupération politique de ce conflit, étant donné que les interventions étrangères ne servent pas les intérêts de la Libye ni n’aident les parties libyennes à transcender leurs intérêts particuliers afin de réaliser l’intérêt commun de tous les Libyens.
Sur d’autres questions arabes, le Maroc n’est pas resté passif. Concernant notamment les situations au Yémen et en Syrie, le Royaume a plaidé pour un engagement sincère afin de trouver des solutions politiques urgentes à même de qui permettre à la population de ces pays de jouir de la sécurité et de la stabilité.
En ce qui concerne les relations arabo-iraniennes, la position du Royaume est restée en harmonie avec celles de la Ligue arabe, qui condamne et rejette notamment l’ingérence de Téhéran, par intervention directe ou par le biais de ses agents, dans les affaires intérieures des pays arabes.
En matière de coopération siono-arabo, le Maroc considère la Chine comme un facteur d’équilibre permettant de soutenir la voie de la paix comme un choix stratégique pour résoudre le conflit palestino-israélien, ainsi qu’un partenaire fiable dans les relations bilatérales, d’autant plus que le Royaume et la Chine sont liés par un partenariat stratégique plus solide.
faapa