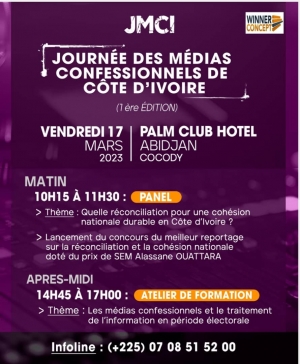Dans le but de contribuer à la lutte contre la résistance aux antimicrobiens (RAM), la firme pharmaceutique pfizer a organisé une table ronde virtuelle autour des medias sur la RAM ce mercredi 15 février 2023 en prélude à la célébration de la semaine mondiale de la lutte contre la RAM qui se tient du 18 au 24 novembre de chaque année.
Cette table ronde virtuelle vise à donner les rudiments nécessaires aux journalistes afin d’informer et sensibiliser les populations sur les dangers sanitaires et économiques causés par la résistance aux antimicrobiens.
Les conférenciers tout en soulignant l’importance de l’implication des journalistes dans cette lutte, les ont exhortés à une collaboration franche et efficace pour la réussite de l’action entreprise.
« La RAM fait rage dans le monde et est devenue un problème de santé publique majeur. Elle est une urgence sanitaire mondiale qui a conduit l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) à adopter un plan mondial », a fait savoir Pr Guessennd Kouadio Aya Nathalie, point focal du GTT- RAM (Côte d’Ivoire).
Non sans rappeler qu’avec un coût élevé pour la santé individuelle et l’économie en général, la RAM est un risque critique si elle n’est pas traitée.
Selon la spécialiste, si les agents pathogènes de la RAM se propagent comme l’a fait la COVID-19, les populations seront confrontées à une autre crise de santé publique.
Dr Sylvie Kounde, responsable médicale de l’Afrique subsaharienne francophone chez Pfizer a affirmé que : « La RAM, si elle n’est pas contrôlée, pourrait conduire à un scénario dans lequel des infections mineures deviennent mortelles et les infections graves deviennent impossibles à traiter », a-t-elle prévenu.
Elle a fait savoir également que malgré les nombreux défis associés au développement de nouvelles molécules anti-infectieuses, Pfizer reste engagé à fournir de nouvelles thérapies efficaces qui ciblent les nouvelles infections émergentes difficiles à traiter.

Et de rassurer : « Nous restons également engagés envers les patients souffrant de maladies infectieuses ».
Rien qu’en 2020, 28 millions de patients ont été traités avec un traitement anti-infectieux de Pfizer. Un nombre en constante augmentation.
En effet, il est bon de savoir que la RAM se produit lorsque les antibiotiques perdent leur efficacité parce que les agents pathogènes trouvent des moyens de résister à leurs effets.
La RAM est certes une menace silencieuse, mais elle est bien réelle et de ce fait il est urgent de s’y attaquer.
Pfizer est convaincu que les gouvernements et la communauté de la santé publique doivent collaborer avec l’industrie pour soutenir les actions qui permettront d’apporter une innovation continue dans le développement de nouveaux antibiotiques et vaccins pour freiner la propagation de la résistance aux antimicrobiens (RAM).
Dans son intervention, professeur BAMBA-PAKOTOGO Sanata a souligné que : « Les antimicrobiens font partie des ressources médicales les plus précieuses que le monde n’ait jamais connues. Il est alarmant qu’ils perdent de leur efficacité », a-t-elle expliqué.
Compte tenu de la faible sensibilisation du public aux dangers de la RAM, il est aussi de la responsabilité de la communauté médicale, d’éduquer les patients sur la situation alarmante. Il est important d’instaurer des mesures de santé publique, de prévention et de surveillance pour freiner sa propagation, a suggéré Pr Bamba- Pakotogo.
Selon l'OMS la RAM provoque 700 000 décès par an dans le monde, un chiffre qui pourrait passer à plus de 10 millions en 2050.
Mohamed Compaoré