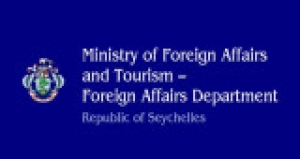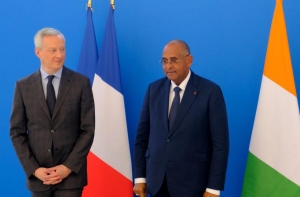La France métropolitaine n’a pas connu de véritable pluie depuis 31 jours, égalant un précédent record datant de 2020, a annoncé, mardi 21 février 2023, l’institut météorologique “Météo-France”.
“La pluie n’est pas tombée en France depuis le 21 janvier, soit une série de 31 jours consécutifs (20 février inclus), du jamais vu durant un hiver météorologique. Tous mois confondus, cette série consécutive égale celle de l’année 2020 entre le 17 mars et le 16 avril”, indique l’organisme public.
Selon Météo-France, le phénomène s’explique par la présence d’un anticyclone solidement installé qui agit comme un bouclier qui repousse les perturbations hors du territoire.
Le mois de février 2023 devrait se terminer avec un déficit pluviométrique de plus de 50%, devenant ainsi l’un des mois de février les plus secs jamais enregistrés depuis le début des mesures en 1959, prévient la même source.
“Sur la totalité du territoire, les sols sont nettement plus secs qu’ils ne devraient l’être à cette période de l’année. On est sur un état qu’on rencontre habituellement mi-avril, soit deux mois d’avance. C’est un assèchement moins important que ce qu’on observe habituellement sur les mois d’été, mais c’est remarquable pour la saison hivernale durant laquelle les sols se sont nettement asséchés sur tout le territoire”, selon les météorologues de l’organisme.
Depuis l’été 2021, la France subit en effet une sécheresse météorologique préoccupante. Depuis août 2021, tous les mois sont déficitaires en pluie à l’exception des mois de décembre 2021, juin 2022 et septembre 2022.
Le manque de pluie sera à nouveau très marqué sur l’ensemble du mois de février 2023, qui marquera la fin d’un hiver remarquablement sec, note Météo-France, relevant que l’hiver 2023 figurera parmi les 10 hivers les moins arrosés depuis 1959.
hn