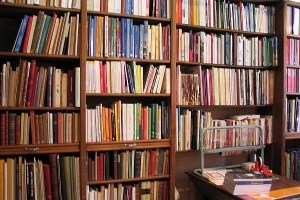Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been....
Armand Tanoh
COP21 : Ce que l’Afrique attend de l’accord global sur le climat
Comme leurs homologues étrangers, plusieurs chefs d’Etats africains se sont exprimés à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la 21ème Conférence de parties (COP 21) qui s’est ouverte le 30 novembre à Paris (France).
L’objectif de cette conférence est de limiter les effets du changement climatique en trouvant un accord global pour maintenir le réchauffement de la planète à un maximum de 2°C d’ici 2100.La remarque qui se dégage des messages des présidents de l’Afrique francophone est que certaines préoccupations reviennent systématiquement.
A l’unanimité, ils appellent ainsi à un accord "contraignant" au terme de la conférence de Paris ; tout comme ils appellent les pays développés à accentuer leur soutien financier à l’endroit des pays du sud.En outre, ils plaident pour une égale prise en compte des questions d’atténuation des changements climatiques et des questions d’adaptation à ces phénomènes.
Enfin, ils en appellent à un transfert de technologies des pays riches vers les pays pauvres. Ceux-ci souffrant le plus des effets des changements climatiques provoqués surtout par les premiers. Les extraits qui suivent montrent enfin que tous sont d’accord sur le fait que l’erreur n’est pas permise à ce sommet.
Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire)
"J’encourage les pays développés à contribuer au fonds vert"
"Le temps est venu de nous approprier les négociations en cours et de donner l’impulsion politique nécessaire, afin de parvenir à un accord contraignant pour tous. Je soutiens à ce propos l’adoption d’une clause de suivi et de révision, ceci permettra aux principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre, d’afficher périodiquement de nouvelles ambitions à la hausse en vue d’atteindre l’objectif de 2° C, voire de 1,5° C, comme demandé par les pays les plus vulnérables.
L’accord qui se dessine ne se réalisera pas sans l’Afrique. Nos priorités devront figurer en bonne place dans le texte, notamment en ce qui concerne les financements et le transfert des technologies de résilience aux changements climatiques. L’engagement des pays développés à mobiliser 100 milliards de dollars par an, d’ici à 2020, en faveur des pays en développement doit demeurer un élément central de nos discussions. Ce montant nous parait toutefois bien en deçà des ressources nécessaires pour faire face aux défis liés au réchauffement climatique.
En outre, il convient dès à présent de prévoir les modalités de financement pour l’après 2020. J’encourage les pays développés et les pays émergents, dans la limite de leur responsabilité, à contribuer davantage, sur fonds publics et sous forme de dons, au Fonds vert pour le climat, afin qu’il finance plus de projets dans nos pays qui subissent, déjà, les effets néfastes des changements climatiques. L’Accord devra également amener les Etats à consacrer davantage de ressources à l’adaptation ; il devra garantir le transfert des technologies propres vers l’Afrique et renforcer les partenariats techniques nord-sud."
Ali Bongo Ondimba (Gabon)
"Les pays industrialisés doivent accentuer le transfert de technologies"
"Nous avons décidé d’interdire le "torchage" des gaz issus de l’extraction pétrolière, en remplaçant progressivement nos centrales à gasoil par des centrales à gaz. En 2025, notre programme actuel de construction des barrages hydrauliques doit nous amener à un mix-énergétique de 80% d’hydroélectricité pour 20% de gaz. Pour maîtriser nos émissions de gaz à effet de serre, dans un pays dont le couvert forestier est de 88% et où l'agriculture n’est pas encore arrivée à maturité, nous avons décidé d’agir sur la rationalisation de l’utilisation des terres.
Ce Plan national d'affectation des terres, qui sera suivi par notre Station de réception d’images satellites, rassemble désormais les données indispensables à l’efficace répartition territoriale de notre tissu économique. De même que notre loi d’orientation de développement durable nous garantira la cohérence dans nos actions. Notre forêt sera gérée dans le strict respect de nos engagements en faveur du climat, mais aussi de la préservation de la biodiversité.
C’est la réponse promise par le Gabon face à l’épineuse question de la déforestation et de la dégradation des forêts. L'heure n'est plus au débat entre le Juste et l'Injuste. Tout le monde doit faire partie de la solution. Pour ce faire, les pays industrialisés doivent accentuer leurs actions en faveur des pays du sud par le transfert de technologies à des coûts soutenables dans les domaines de l’agriculture, de la foresterie et des énergies propres.
C’est le prix d’une responsabilité partagée pour ne pas rompre la confiance et la solidarité et parvenir à un accord universel aussi engagé que possible, sans lesquelles nos discours resteront vains. Agissons enfin, pour ne pas être responsables de ce que nous pouvons encore éviter. Sinon, le jugement de l’Histoire sera sévère."
Paul Biya (Cameroun)
"Sauvons le lac Tchad"
"Notre conférence répond en effet à l’urgente nécessité d’enrayer les effets destructeurs des changements climatiques. Nous en avons la responsabilité. Nous en avons le devoir. Et ici, nous en avons l’opportunité. Nos conclusions, nos compromis, pour être crédibles, devront avoir un caractère contraignant. La tâche n’est pas insurmontable. Laissons-nous seulement guider par une exigence de solidarité humaine et une juste appréciation de l’urgence de la situation. Nous n’avons pas le droit d’échouer. Le Cameroun, faible émetteur de gaz à effet de serre, entend poursuivre sa contribution à leur réduction. Cette contribution se décline comme suit. Primo : plan de réduction de 32 %, à l’horizon 2035, de l’empreinte carbone par rapport à 2010. Secundo : lutte contre la désertification, élaboration d’un mécanisme pour le développement propre, gestion durable des forêts et, dans le cadre de la Commission des forêts d’Afrique centrale, action pour une gestion concertée des forêts du bassin du Congo. Tertio : gestion durable des ressources en eau de concert avec les pays de la sous-région, membres de la Commission du bassin du lac Tchad et de l’Autorité du bassin du Niger.
Deux sujets interpellent la COP21. Il s’agit d’abord de la dégradation continue des forêts en Afrique Centrale. Celle-ci diminuera la contribution de ce massif forestier à la réduction des gaz à effet de serre. Nous devons sauver les forêts du bassin du Congo. Nous devons sauver le second poumon de la planète.
La désertification qui affecte les pays voisins du lac Tchad, nous préoccupe également. Cet immense plan d’eau, absolument indispensable à la vie des populations et à la biodiversité, est en voie d’assèchement progressif. Il a déjà perdu 90 % de sa surface initiale. Sauvons le lac Tchad."
Issoufou Mahamadou (Niger)
"L’accord doit reposer sur le principe de responsabilité collective mais différenciée"
"Dans mon pays les effets du changement climatique se traduisent non seulement par l’augmentation des températures extrêmes, mais aussi, dans la même saison, par des périodes de sécheresse suivies de périodes d’inondations provoquant dans les deux cas des pertes et dommages considérables et mettant à mal la résilience des populations. Le Niger attend par conséquent des pays partenaires développés et émergeants, un signal fort sur leurs engagements, notamment celui de mobiliser 100 milliards de dollars par an jusqu’en 2020 pour financer les politiques climatiques à travers les fonds verts, ce montant devant être revu à la hausse au-delà de cette période.
Le Niger engage vivement les Etats membres que nous sommes à agir dans le cadre d’un accord que nous voulons complet solidaire et contraignant, pour réduire fortement les émissions mondiales, de façon à contenir l’élévation de la température moyenne du globe en dessous de 1,5°C à l’horizon 2100, car de l’avis des experts, le seuil de 2°C en moyenne communément annoncé se traduirait en fait, pour l’Afrique par une élévation moyenne de température de 3,5°C, et de 5°C pour le Niger.
Mais le Niger attend évidemment de voir cet accord réserver une place de choix aux questions importantes notamment la prise en compte, de manière équilibrée, des actions d’atténuation et des actions d’adaptation en ce qui concerne le financement , ainsi que la définition de mécanismes clairs pour garantir ce financement.
Il est en définitive temps que la communauté internationale s’accorde autour d’un accord universel assorti d’un agenda de solutions, reposant sur le principe de responsabilité collective mais différenciée. L’Afrique avec une contribution aux émissions de 2% se présente comme une victime subissant les effets des émissions à effet de serre des pays développés et émergents. Il faut que les pollueurs payent suivant le principe universellement admis du pollueur payeur."
Hery Martial Rakotoarimanana Rajaonarimampianina (Madagascar)
"Parvenir à un accord incluant les dédommagements équitables"
"Si les frontières en tous genres nous inclinent parfois à l’égocentrisme, il nous faut garder à l’esprit que le changement climatique lui, ignore nos frontières. Il nous appartient de prendre des décisions immédiates, contraignantes pour tous et inscrites sur la durée. Entre autres, celle de limiter à moins de 2 degrés Celsius l’augmentation de la température mondiale à la fin de ce siècle.
Le principe 21 du Droit international de l’environnement stipule : "les Etats ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d’autres Etats". Madagascar, entièrement acquis à ce principe, souhaite ainsi parvenir à un accord incluant les dédommagements équitables au regard des pertes et préjudices engendrés par le réchauffement climatique qu’il subit.
J’appelle ainsi notre solidarité et notre prise de responsabilité pour que cette COP21 puisse aboutir à un engagement politique très ambitieux. Je suis convaincu que nous tous, ici présents, avons le pouvoir et le devoir de rendre la justice climatique à 7 milliards d’humains qui nous regardent et nous écoutent."
Thomas Boni Yayi (Bénin)
« Que la COP 21 nous donne les moyens de nous adapter"
"Notre premier souci est de transformer le changement climatique en opportunité de développement et il est impératif que la COP 21 nous donne les moyens de nous adapter à la situation. Ces moyens doivent absolument tenir compte de ce que nous sommes des pays en développement et pour la plupart des Etats côtiers ou sahéliens menacés de disparition. La COP 21 doit donc donner lieu à un accord global, ambitieux et contraignant permettant de respecter l’engagement de maintenir le réchauffement climatique en dessous du seuil critique de 2°C. Il est également impérieux que l’accord sur le climat réponde aux difficultés rencontrées par l’Afrique en matière d’adaptation, de financement, de transfert de technologie, de savoir et de renforcement des capacités. L’équité doit se fonder sur la répartition des moyens d’adaptation. Il importe également d’intégrer dans cet accord un mécanisme de suivi-évaluation qui permette d’identifier les difficultés d’application méritant une attention particulière de la part de la communauté internationale. Comme vous le savez, pauvreté et dérèglement climatique sont véritablement liés. L’heure est grave. L’heure est véritablement grave. Agissons à une gouvernance concertée de notre planète Allons à la surveillance multilatérale, allons à une autorité mondiale de coordination et de régulation des objectifs contre les dérèglements climatiques".
Ismaïl Omar Guelleh (Djibouti)
"Les pays développés doivent montrer l’exemple"
"Nous ne pourrons gagner la lutte contre le changement climatique que si nous prenons des mesures drastiques pour réduire l’émission des gaz à effet de serre. Conformément au principe de responsabilité commune, mais différenciée, les pays développés qui ont une responsabilité historique dans le réchauffement climatique et qui ont les capacités technologiques et financières suffisantes doivent montrer l’exemple en réduisant de façon substantielle leurs émissions de gaz à effet de serre. (…) La mobilisation des pays du sud en général et l’Afrique en particulier face aux défis du climat sera d’abord conditionnée par la capacité qu’auront les pays du nord à apporter des réponses plus consistantes aux deux questions sur lesquelles l’Afrique les attend : d’une part, celle de l’adaptation aux effets du changement climatique et de son financement, d’autre part celle des transferts de technologie. A l’instar des autres pays africains, l’adaptation reste la priorité du gouvernement djiboutien. (…)Toutes les actions prises pour faire face à ces phénomènes climatiques extrêmes doivent être financés. C’est pourquoi nous demandons à ce que le financement international mobilisé dans le cadre de la lutte contre le changement climatique soit équitablement partagé entre les actions d’atténuation et les actions d’adaptation. A ce sujet, nous sommes inquiets de la tendance actuelle qui comme l’a révélé le récent rapport de l’OCDE (…) montre que seulement 17% du financement est consacré à l’adaptation. Ce qui reste largement insuffisant. Négliger l’adaptation, c’est donc oublier que le changement climatique frappe déjà beaucoup de pays et que son impact négatif ne fera que croître, quelles que soient les mesures d’atténuation qui seront prises. Aujourd’hui, nous nous sommes réunis pour adopter un nouvel accord universel et, j’espère, juridiquement contraignant. Instruits par l’expérience du protocole de Kyoto et par l’échec du sommet de Copenhague, nous devons prendre les décisions qui s’imposent pour trouver un accord qui, d’une part, n’exclut aucun pays, et d’autre part, qui soit juste et équitable. Pour ce faire, il faudra sans doute accepter, et avant qu’il ne soit trop tard, d’ouvrir le pré-carré des souverainetés nationales pour asseoir le cadre d’une réponse efficace à la menace la plus globale qu’ait connue l’humanité."
Macky Sall (Sénégal)
« L’accord doit être contraignant »
"Suivant le principe bien connu de pollueur-payeur et la responsabilité commune, mais différenciée, il y a urgence à conclure un accord pour limiter la hausse des températures sous le niveau contenu de 2°C. Pour atteindre l’efficacité voulue, cet accord doit être contraignant, applicable à tous, juste et équitable. Certes, tous les pays doivent chacun contribuer à l’effort de réduction des gaz à effet de serre, notamment par la limitation des sources d’énergie plus polluantes, mais moins coûteuses. Mais, pour nous, pays en développement, africains en particulier, renoncer à ces sources entraîne des pertes de compétitivité qui amplifient davantage notre retard sur le processus d’industrialisation et de développement. Rien que pour l’Afrique, le coût de l’adaptation est estimé entre 7 et 15 milliards de dollars par an. Par conséquent, il est important que le fonds vert climat soit doté de ressources adéquates pour accompagner les efforts d’adaptation et soutenir le transfert de technologies écologiquement viables. Avec ses ressources hydriques abondantes et son énorme potentiel en énergie solaire, l’Afrique réunit les conditions pour un accès universel rapide à l’électricité. (…) L’Union africaine a appelé lors du dernier sommet à la création d’un mécanisme piloté par l’Afrique pour coordonner les initiatives dédiées au continent en matière d’électricité. Le Sénégal, en sa qualité de président du NEPAD, appelle les pays partenaires à consacrer une partie des ressources destinées au fonds vert aux mécanismes pour l’électrification de l’Afrique en raison de 5 milliards de dollars par an au moins sur dix ans. Quand on demande aux pays les plus en retard sur le processus de développement de renoncer aux sources d’énergie les plus accessibles et les moins coûteuses que d’autres ont utilisées pendant des décennies pour assurer leur industrialisation, l’équité veut que cet effort soit accompagné et soutenu."
AIP
Les responsables d’Afreximbank reçoivent l’accord d’établissement de leur succursale d’Abidjan
L’ambassadeur de Côte d’Ivoire en Egypte, Eugène Allou-Allou, a remis, lundi au Caire en Egypte, l’accord d’établissement d’une succursale de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), aux responsables de cette institution.
Remettant ce document au président d’Afreximbank Dr. Benedict Oramah, au siège de la Banque, M. Allou-Allou s’est réjoui du choix stratégique d’Abidjan pour abriter ce bureau régional qui va desservir l’Afrique de l’Ouest francophone.
L’accord portant création de la succursale d’Afreximbank à Abidjan a été ratifié par le gouvernement ivoirien le 3 juin, alors que cette représentation avait démarré ses activités en mai, suite à la signature de la convention d’établissement entre la Banque et les autorités de Côte d’Ivoire, ainsi que l’adoption des obligations et des responsabilités y afférentes.
Pour Dr. Oramah, le bureau d’Abidjan constitue "un instrument d’une importance majeure dans la réalisation du mandat d’Afreximbank, qui vise à promouvoir le commerce intra-africain et à soutenir le développement des exportations africaines à forte valeur ajoutée".
Abidjan, a-t-il justifié, était "le choix naturel du fait de la contribution significative de la Côte d’Ivoire dans la création de la Banque, et également de son rôle de plaque tournante dans l’économie de la sous-région".
Le président a expliqué que la Côte d’Ivoire avait prouvé qu’il était possible pour un pays africain de développer son économie à partir de l’agriculture.
”Cette nation a réussi à s’imposer comme le premier producteur mondial de cacao et tout récemment comme le plus grand exportateur de noix de cajou au monde. C’est aussi un pôle industriel qui sert de passerelle pour beaucoup de pays enclavés de la sous-région. » a-t-il dit, assurant qu’Afreximbank utilisera la nouvelle succursale pour atteindre ses principaux objectifs de développement.
La succursale d’Abidjan qui devra entreprendre des activités de marketing, de développement des affaires, de gestion des relations clientèle dans les pays d’Afrique de l’Ouest francophone, viendra "soutenir la croissance rapide des activités de la Banque dans la zone CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) qui, évaluée à 1,817 milliards de dollars US, soit près de 1000 milliards de francs CFA, représente 52% des comptes annuels de la Banque.
Le Conseil d’administration d’Afreximbank avait approuvé, en juin 2014 à Libreville (Gabon), lors de la dernière Assemblée générale des actionnaires, la création d’une nouvelle succursale pour servir l’Afrique de l’Ouest francophone et une autre pour l’Afrique de l’Est.
En plus d’Abidjan, Afreximbank possède des succursales à Harare (Zimbabwe), à Abuja (Nigeria) et ouvrira très bientôt une succursale à Nairobi (Kenya). Le Siège social est basé au Caire (Egypte).
Le soutien de cette banque à l’économie ivoirienne s’élève à un montant cumulé de facilités approuvées de 2,518 milliards de dollars US (1300 milliards FCFA) depuis 1994, principalement en faveur de transactions dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l’agriculture, des services financiers, du transport et des infrastructures touristiques.
AIP
Dédicace de l’œuvre « Adama Ouédraogo, une vie de pasteur: la vie et l'œuvre de l'homme »
Le Docteur Aimé ADOPO organise le dimanche 06 décembre 2015 à 15H00 au sein de l’Eglise des Assemblées de Dieu de la Riviera 2, la dédicace de son œuvre « ADAMA OUEDRAOGO, UNE VIE DE PASTEUR : LA VIE ET L’ŒUVRE DE L’HOMME ».
L’œuvre éditée par le Centre de Publication Evangélique (CPJ), témoigne de la vie d’un homme de Dieu.
A travers ce livre biographique, l’auteur veut mettre au grand jour la vie d’un grand serviteur de Dieu, le Révérend Adama OUEDRAOGO, dont le ministère exceptionnel est unanimement reconnu. Comment celui-ci a pu garder intact le bon témoignage et la foi authentique au Seigneur pendant plus de 40 ans de ministère, plus de 40 ans de mariage, plus d’un demi-siècle (50 ans) de vie chrétienne ?
C’est autant de questions que Dr Aimé ADOPO essaie de faire découvrir par la vie de ce serviteur de Dieu très effacé, qui arriva en Côte d’Ivoire dès l’âge de 16 ans, qui répondit à l’appel de Dieu à 22 ans et à qui échut, à 29 ans, la direction de la grande assemblée mère des Assemblées de Dieu d’Abidjan (1974).
L’auteur Dr Aimé ADOPO Achi est un laïc de l’église des Assemblées de Dieu de Côte d’Ivoire, qui s’est résolument mis au service du Seigneur dès sa conversion. Il fut notamment président de la jeunesse de l’assemblée locale de Babré Gagnoa.
Membre de l’assemblée locale de la Riviera 2 depuis novembre 2004, il en est le responsable du comité des témoins et conseillers. Professeur d’Université, il enseigne la grammaire française à l’Ecole Normale Supérieure (E. N. S.) d’Abidjan.
Le « challenge », premier critère pour choisir un emploi chez la femme ivoirienne (Etude)
Selon une enquête réalisée en Côte d’Ivoire par everjobs, un portail d’emploi international opérant dans 6 pays en Afrique, 20% de femmes sont motivées par le challenge dans le choix de leur emploi, 19% par l’évolution de carrière et le salaire, 16% par la famille, 14% par la montée de compétence et seulement 11% par l’envie d’occuper des responsabilités.
Il ressort également de cette étude que le Marketing occupe la première place dans le choix des femmes en matière d’emploi. Suivent la comptabilité/Finance, le management puis l’Entreprenariat. En dépit des efforts consentis par le Gouvernement ivoirien, il subsiste des freins à la carrière des femmes en Côte d’Ivoire. Il s’agit entre autres de l’accès inégal à l’éducation, à l’enseignement supérieur et aux financement, l’inégalité des genres aux postes de responsabilité, la pression familiale, le contexte culturel et stéréotypé sur la femme, la phallocratie et le manque de confiance en soi, le complexe d’infériorité.
Pour résorber cet état de fait, les femmes suggèrent plus de formations à l’attention des femmes au sein des entreprises, encourager l’éducation des filles, adapter le droit du travail pour favoriser les carrières professionnelles féminines, promouvoir l’égalité des chances hommes/femmes, et enfin une rémunération proportionnelle aux responsabilités occupées.
Selon toujours cette étude, pour le mois d’octobre, le secteur des TIC demeure en tête des secteurs enregistrant les taux les plus élevés de demande, suivi par les secteurs des BTP et de la Banque. En revanche, on note un accroissement de la demande pour le secteur des Organisations Non Gouvernementales (ONG).
Elisée B.
Côte d'Ivoire : HEC Paris s’engage aux côtés du patronat pour développer les compétences des cadres ivoiriens
HEC Paris organise ce jour une conférence sur le digital, accélérateur pour le développement et la croissance en Afrique subsaharienne en collaboration avec la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), le patronat ivoirien. À cette occasion, l’école de commerce présente le cursus MUST (Management d’une unité stratégique), un programme académique de haut niveau destiné aux cadres supérieurs de Côte d’Ivoire qui souhaitent renforcer leur expertise managériale et entrepreneuriale.
Cette formation de quatre mois, dont la prochaine promotion doit débuter à Abidjan en janvier 2016 répond à un besoin de développement de compétences des talents ivoiriens. « Ce cursus est une boîte à outils qui permet aux cadres d’horizons variés de faire face aux enjeux stratégiques auxquels est confrontée leur organisation. C’est en outre un certificat d’enseignement supérieur (CESA) reconnu à l’international qui peut être complété par un Executive Mastère Spécialisé à Paris à HEC Paris », détaille Sean Kilbride, Directeur du développement à HEC Paris Executive Education.
À l’heure où les groupes internationaux font de moins en moins souvent appel aux personnels expatriés, HEC Paris entend accompagner les parcours de carrière des cadres ivoiriens au travers de programmes de formations diplômantes. « Le renforcement des compétences des cadres de la Côte d’Ivoire est un passage obligé pour que le secteur privé puisse jouer son rôle de moteur de l’émergence de notre pays. Depuis septembre 2014, la CGECI a choisi de faire confiance à HEC Paris pour son expérience internationale en matière de formation continue des managers et des dirigeants », se félicite Jean Kacou Diagou, président de la CGECI.
Actif en Afrique depuis les années 1970, le groupe HEC Paris développe des programmes d’accompagnement de formation proposés aux dirigeants des secteurs public et privé en partenariat avec le patronat local. Présent dans huit pays à travers le continent et fort de 350 chefs d’entreprise africains, le réseau des HEC Executive clubs constitue une plateforme dynamique pour encourager les échanges et le partage de bonnes pratiques. Plus largement, HEC Paris s’appuie sur un réseau d’anciens élèves qui occupent les postes clés dans les plus grandes entreprises africaines et internationales implantées sur le continent.
agenceecofin.com
"PlaYce", l’hypermarché Carrefour d’Abidjan : Une vraie réponse pour accompagner la classe moyenne émergente
« PlaYce », marque officielle des centres commerciaux opérés par CFAO en Afrique, a été dévoilée ce jour à Abidjan (Côte d’Ivoire) par le groupe de distribution international. Avec une superficie totale de 20 000 mètres carrés, le premier centre commercial « PlaYce » ouvrira ses portes à Abidjan, dans le quartier de Marcory, en décembre 2015.
Le centre commercial PlaYceMarcory est le premier d’une série de plusieurs dizaines de centres qui seront ouverts dans huit pays d’Afrique et opérés par CFAO.
À l’instar de PlaYceMarcory, les prochains centres commerciaux prendront la dénominationPlaYce à laquelle sera ajouté le nom de leur zone d’implantation.
« Les centres commerciaux PlaYce offrent la promesse de pouvoir accéder à un espace de consommation moderne, séduisant et abordable ; la promesse du shopping de nouvelles marques internationales grâce à la présence systématique des quinze enseignes du Club de Marques CFAO Retail ; la promesse de toujours trouver un hypermarché Carrefour... PlaYce, c’est une nouvelle expérience client et c’est aussi notre Marque de centres commerciaux au service des consommateurs africains ! », a expliqué
Xavier Desjobert, Directeur Général de CFAO Retail.
Situé sur le Boulevard VGE, l’une des artères principales d’Abidjan, PlaYceMarcory participe par l’originalité et la beauté de son architecture à l’embellissement de la ville. Cette architecture fait partie de l’ADN de la Marque : tous les centres commerciaux PlaYce seront immédiatement reconnaissables.
Engagée au titre de sa responsabilité sociétale, la marque PlaYce veut devenir une référence en Afrique de l’Ouest et Centrale. Sa conception, son design et ses normes de sécurité et d’hygiène sont au niveau des meilleurs standards internationaux.
Au cœur de PlaYce, une agora, véritable lieu de rassemblement, de loisirs et d’échanges symbolisé par le Y placé au cœur du mot « place ». Le centre commercial développé par CFAO a été conçu sur l’idée de rassembler la population autour d’un lieu de partage innovant et chaleureux. PlaYce veut être un lieu de vie convivial autant qu’un lieu de consommation moderne.
À l’image des trois branches du Y, PlaYce Marcorysera articulé autour de trois pôles principaux : l’hypermarché Carrefour, la galerie commerciale composée d’une cinquantaine de boutiques et d’un « food court » qui proposera une offre de restauration. La galerie commerciale et le food court comprennent notamment les enseignes qui ont rejoint le Club de Marques CFAO Retail.
Armand Tanoh
Trafic de sang humain en Côte d'Ivoire: un suspect arrêté à Divo
La police du premier arrondissement de Divo a procédé, mardi, à l'arrestation d'un présumé trafiquant de poches de sang humain au quartier Konankro-petit marché de la localité.
Le suspect nommé Zoum Gnomblehon Eric, présenté comme ancien garçon de salle au CHR de Divo, avait en sa possession, selon la police, "deux poches de sang dont l’une périmée, bien tenues dans un réfrigérateur".
Il avait également, poursuit la même source, 45 performeurs et une fausse carte d’agent de santé en sa possession.
Sous surveillance discrète de la police depuis quelques jours, le présumé trafiquant a fini par tomber dans les mailles des forces de l’ordre qui, se faisant passer pour des acheteurs, se sont vus livrer la poche de sang par la concubine de Zoun Eric.
Dans ce trafic, les poches de sang, conservées dans une maisonnette à Konankro, où elles côtoient des sachets de jus de fruits divers ( bissap , gnamankoudji) dans le réfrigérateur, revient au client à 35.000 FCFA. Un coût beaucoup plus élevé que celui pratiqué dans les banques de sang où le prix de la poche, subventionnée par l'Etat, varie de 3500 à 25.000 FCFA.
Les hommes du commissaire Edson Kouamé ont décidé d’intensifier leur enquête et d’entendre tous les sachants susceptibles d’aider à démanteler tout éventuel réseau de trafic de sang dans la ville.
Depuis plusieurs mois, la ville de Divo bruisse de rumeurs de vente de sang en dehors du circuit normal.
Les autorités sanitaires ont pour leur part toujours décliné toute responsabilité, invitant les usagers à "suivre la voie normale pour s’approvisionner en sang".
Source : AIP
Côte d’Ivoire : une nouvelle cimenterie bientôt en construction à Anyama
La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) accorde à la société Ivory Diamond Cement SA (IVOCEM SA), un prêt d’un montant de 7,5 milliards de FCFA pour l’implantation d’une unité de broyage de clinker à Anyama (30 kilomètres d’Abidjan) en Côte d’Ivoire. Cette intervention, qui représente 46,3% du coût total du projet, s’inscrit dans le cadre d’un mandat de syndication confié à United Bank of Africa (UBA) Côte d'Ivoire.
La convention y relative a été signée par Messieurs Bassary TOURE, Vice-Président de la BOAD, Rohist Prasad MOTAPARTI, Directeur général d’IVOCEM, et Franklin EREBOR, Directeur général de UBA Côte d'Ivoire.
L’unité de broyage de clinker aura une capacité de 500 000 tonnes de ciment par an. Ce projet se justifie par l’existence d’un marché porteur, caractérisé par une insuffisance de l’offre de ciment et une demande à fort potentiel de croissance.
Cet accord est le troisième entre la BOAD et les promoteurs de la société IVOCEM SA, après l’implantation, au Mali et au Niger, de deux cimenteries intégrées, avec des financements respectifs de 9, 5 milliards de F CFA et 12, 5 milliards de F CFA.
Source : agenceecofin.com
L’ONUCI organise une session de dialogue inter communautaire à Neko
Les chefs traditionnels, les élus et les cadres, les femmes et les jeunes des différentes communautés du village de Neko, située à 10 km de Lakota, dans la région du Loh-Djiboua du centre-ouest de la Côte d’Ivoire, se sont engagés à renforcer la cohésion sociale dans leur village. Ils ont pris cet engagement à l’issue d’une session de dialogue inter communautaire, organisée au Foyer des jeunes de Néko, les 18, 19 et 20 novembre 2015 par l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) suite aux événements malheureux que cette localité a vécu les 8 et 9 novembre 2015, ayant occasionné un mort et des dégâts matériels.
La Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies, Mme Aïchatou Mindaoudou, le Directeur Général de la Solidarité et de la Cohésion Sociale, représentant la Ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant, M Doh Dibahi Marcellin, la Directrice Générale de l’Observatoire de la Solidarité de la Cohésion Sociale, Mme Elise Yra Ouattara, le Préfet du Département de Lakota, Yahaya Coulibaly, les représentants des forces de sécurité du département, ont pris part à la clôture de cette session de dialogue inter communautaire. La veille, la Représentante de l’Union africaine, Mme Josephine Mayuma Kala, avait participé aux échanges en présence des autorités préfectorales et communales.
Plus de 300 participants ont échangé pendant trois (3) jours sur leur contribution pour le retour durable de la cohésion sociale dans la localité. Les échanges ont été organisés à travers quatre ateliers regroupant respectivement les femmes, les jeunes les élus et les cadres ainsi que les autorités traditionnelles et religieuses
Les rapporteurs des différents groupes ont présenté leurs engagements pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale.
Le Porte-parole du groupe des jeunes, M Bado Emmanuel, a relevé entre autres défis le manque de respect mutuel et de tolérance entre les jeunes des différentes communautés et le non respect de la loi. Dans leurs recommandations ils se sont engagés à « cohabiter sans distinction politique, ethniques et religieuses et à mettre en place un comité d’échange entre les différents groupes des jeunes».
La Porte-parole du groupe des femmes, Mme Soumahoro Matogoma, a fait savoir que les femmes ont proposé de « conseiller leurs fils et de sensibiliser les habitants du village pour la restitution des biens volés ». Les femmes ont demandé un appui technique et financier pour la création d’une fédération des associations féminines de Néko.
Le Porte-parole du groupe des élus et des cadres Lt Dago Alphonse, a souligné les contraintes liées à l’éducation, le foncier et le chômage des jeunes. « Les élus et les cadres ont une responsabilité particulière, celle d’être engagés à favoriser la cohésion entre les communautés de Néko et à promouvoir l’apaisement en cas de tension quelles que soient les communautés impliquées», a dit M Dago.
L’engagement des chefs traditionnels, chefs de communautés et des guides religieux à « se retrouver plus fréquemment pour réapprendre à vivre ensemble pour favoriser la cohésion sociale » lu par leur porte-parole, M Agodio Ben, a bouclé la série des recommandations.
Le représentant de la Ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant, M Doh Dibahi Marcellin, dans son intervention a souligné l’importance du retour de la paix dans ce village. Il a traduit les remerciements de Mme la Ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant à la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour les efforts qu’elle déploie en faveur de la cohésion sociale.
La Chef de l’ONUCI, Mme Mindaoudou dans son intervention a salué la mobilisation des chefs traditionnels, les élus et les cadres, les femmes et les jeunes des différentes communautés du village de Neko. Elle a relevé un point qui est revenu dans les différentes interventions relatifs à « l’indiscipline des jeunes, le manque de maitrise de soi». A cet égard, la chef de l’ONUCI a souhaité que les jeunes changent de comportement et pour se faire elle a proposé que l’ONUCI les accompagne à travers des formations pour le règlement des conflits et la sensibilisation.
Le Préfet de Département de Lakota, Yahaya Coulibaly a clos la session de dialogue communautaire par une adresse dans laquelle il a insisté sur le respect par les jeunes des autorités locales, coutumières et administratives, le respect des lois et règlements par tous, la valorisation des terres cultivables et l’emploi des jeunes ainsi que la nécessité « d’une cohabitation plus inclusive gage le plus sur du vivre ensemble ».
La cérémonie a été ponctuée de prestations artistiques dont celle de la troupe théâtrale de Bouaké « C’est ça la même » qui accompagne l’ONUCI dans ses activités terrain de sensibilisation à la cohésion sociale.
Forum Investir au Congo Brazzaville : Une première édition couronnée de succès
« Le Forum ICB 2015 a tenu ses promesses. Toutes ses promesses. Bien au-delà de nos attentes initiales.» Ce sont sur ces paroles prononcées M. Isidore Mvouba, Ministre d'état, ministre du développement industriel et de la promotion du secteur privé du Congo, que le rideau est tombé sur le Forum ICB 2015-Investir au Congo Brazzaville. Plus de 1000 participants, venus de toute l'Afrique et du monde entier, s'étaient réunis dans la capitale congolaise, du 19 au 21 novembre, pour ce premier forum dédié à la promotion des opportunités d'investissements au Congo. À l'instar de la première journée, le potentiel économique du Congo était au cœur des conférences de haut niveau qui ont rythmé la deuxième journée du forum. Participants et experts ont ainsi pu échanger sur la politique de décentralisation du Congo, favorisant l'essor de nouveaux centres d'activités, ainsi que la position géostratégique du pays en Afrique Centrale. Mines et hydrocarbures, Innovation et TIC, Zones Economiques Spéciales et PME : les nouveaux réservoirs de croissance et d'emplois du Congo étaient également à l'ordre du jour des ateliers de cette deuxième journée.
Lors de la cérémonie de clôture, M. Mvouba a mis en exergue la réussite du Forum ICB 2015 : "ICB 2015 aura été un grand moment du donner et du recevoir. ICB 2015 a prouvé que l'on peut faire de très bonnes affaires au Congo. Au regard de l'affluence record qu'il a connu, des différentes délégations qui rivalisaient d'ardeur et des débats et communications de très bonne qualité, ICB 2015 a conforté l'image de marque du Congo".
|
Signature de contrat pendant l'ICB, entre Le MEDEF international et le PADE
|
Véritable plateforme de croissance et d'opportunités, le Forum ICB 2015 s'est conclu par de nombreuses signatures de protocoles d'accord entre investisseurs étrangers et opérateurs économiques Congolais. Entre notamment la Chambre de commerce de Brazzaville et le patronat turc (DEIK) ou encore entre Congo Capital Entreprises et la Confédération générale des entreprises marocaines (CGEM) et le Centre marocain de promotion des exportations (Maroc Export). Ces derniers devant appuyer Congo Capital Entreprises dans son développement. A noter également une signature de partenariat entre le Projet d'Appui à la diversification de l'économie (PADE) -Groupe Banque Mondiale et la République du Congo - et le Mouvement des entreprises de France international (MEDEF INTERNATIONAL), visant à organiser des activités de promotion des investissements au Congo dans les chaînes de valeur hors pétrole. A ce titre, M. Mvouba a promis que des mécanismes de soutien et d'accompagnement seraient mis en place par le gouvernement pour le suivi des différents protocoles d'accords paraphés.
Avec plus de 50 exposants locaux et internationaux, une affluence record, de nombreuses délégations étrangères et une multitude de partenariats signés, le Forum Investir au Congo Brazzaville s'est d'ores et déjà affirmé comme le rendez-vous incontournable de la promotion des opportunités d'affaires au Congo. L'engouement suscité à l'échelle nationale et internationale aura permis de mettre en avant auprès des investisseurs du monde entier le potentiel économique du Congo et les opportunités qu'il recèle. « Le Forum ICB 2015 a tenu ses promesses. Toutes ses promesses. Bien au-delà de nos attentes initiales.» Ce sont sur ces paroles prononcées M. Isidore Mvouba, Ministre d'état, ministre du développement industriel et de la promotion du secteur privé du Congo, que le rideau est tombé sur le Forum ICB 2015-Investir au Congo Brazzaville. Plus de 1000 participants, venus de toute l'Afrique et du monde entier, s'étaient réunis dans la capitale congolaise, du 19 au 21 novembre, pour ce premier forum dédié à la promotion des opportunités d'investissements au Congo. À l'instar de la première journée, le potentiel économique du Congo était au cœur des conférences de haut niveau qui ont rythmé la deuxième journée du forum. Participants et experts ont ainsi pu échanger sur la politique de décentralisation du Congo, favorisant l'essor de nouveaux centres d'activités, ainsi que la position géostratégique du pays en Afrique Centrale. Mines et hydrocarbures, Innovation et TIC, Zones Economiques Spéciales et PME : les nouveaux réservoirs de croissance et d'emplois du Congo étaient également à l'ordre du jour des ateliers de cette deuxième journée.
Lors de la cérémonie de clôture, M. Mvouba a mis en exergue la réussite du Forum ICB 2015 : "ICB 2015 aura été un grand moment du donner et du recevoir. ICB 2015 a prouvé que l'on peut faire de très bonnes affaires au Congo. Au regard de l'affluence record qu'il a connu, des différentes délégations qui rivalisaient d'ardeur et des débats et communications de très bonne qualité, ICB 2015 a conforté l'image de marque du Congo".
|
Signature de contrat pendant l'ICB, entre Le MEDEF international et le PADE
|
Véritable plateforme de croissance et d'opportunités, le Forum ICB 2015 s'est conclu par de nombreuses signatures de protocoles d'accord entre investisseurs étrangers et opérateurs économiques Congolais. Entre notamment la Chambre de commerce de Brazzaville et le patronat turc (DEIK) ou encore entre Congo Capital Entreprises et la Confédération générale des entreprises marocaines (CGEM) et le Centre marocain de promotion des exportations (Maroc Export). Ces derniers devant appuyer Congo Capital Entreprises dans son développement. A noter également une signature de partenariat entre le Projet d'Appui à la diversification de l'économie (PADE) -Groupe Banque Mondiale et la République du Congo - et le Mouvement des entreprises de France international (MEDEF INTERNATIONAL), visant à organiser des activités de promotion des investissements au Congo dans les chaînes de valeur hors pétrole. A ce titre, M. Mvouba a promis que des mécanismes de soutien et d'accompagnement seraient mis en place par le gouvernement pour le suivi des différents protocoles d'accords paraphés.
Avec plus de 50 exposants locaux et internationaux, une affluence record, de nombreuses délégations étrangères et une multitude de partenariats signés, le Forum Investir au Congo Brazzaville s'est d'ores et déjà affirmé comme le rendez-vous incontournable de la promotion des opportunités d'affaires au Congo. L'engouement suscité à l'échelle nationale et internationale aura permis de mettre en avant auprès des investisseurs du monde entier le potentiel économique du Congo et les opportunités qu'il recèle.